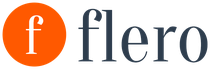POUR culturellement et historiquement, le concept de "bibliographie" apparaît à un certain stade de la formation de l'activité d'information, lorsque le besoin de développement ciblé de ce domaine le plus important est réalisé activités sociales, culture. A notre époque, on peut parler avec une entière certitude de quatre grandes périodes de l'histoire de la bibliographie : Période I - l'émergence en La Grèce ancienne la bibliographie (Ve siècle av. J.-C.) comme écriture de livre, comme travail de scribe ("bibliographe"); Période II - l'émergence de la bibliographie (XVII-XVIII siècles) en tant que science généralisante sur le livre et le commerce du livre (activité d'information) et en tant que spécialité genre littéraire; Période III - l'émergence de la bibliographie (fin du 19e - début du 20e siècle) en tant que science spéciale du cycle de la science du livre (information); Période IV (moderne) - prise de conscience de la bibliographie en tant que domaine particulier du commerce du livre (information) avec sa propre discipline spécifique - la bibliographie.
Des scientifiques nationaux, en particulier A.N. Derevitsky, A.I. Malein, A.G. Fomin, M.N. Kufaev et K.R. Simon, ont également contribué au développement de l'origine et de l'histoire du développement de la bibliographie à l'étranger.
Première période telle qu'établie au début du XXe siècle. notre compatriote A.I. Malein, est associé à l'apparition et au fonctionnement du mot même "bibliographie" dans la Grèce antique au Ve siècle. AVANT JC. Le sens principal de ce mot n'était "pas la DESCRIPTION du livre, mais l'ÉCRITURE du livre, c'est-à-dire la création ou la distribution d'un livre en utilisant la seule méthode disponible dans l'Antiquité pour cela - l'écriture ou la correspondance" [Malein A.I. Sur le terme "bibliographie"//Bibliogr. feuilles Rus. bibliologue. îles. 1922. L. 1 (janvier). S. 2-3]. En d'autres termes, la bibliographie dès le début de son apparition signifiait ce que nous appelons aujourd'hui "l'activité du livre", ou plus largement - "l'activité d'information".
Deuxième période associé à la formation en Europe du XVIIe siècle. système des sciences, qui existe toujours avec quelques changements et ajouts. Le mot "bibliographie" avec d'autres - bibliologie, bibliosophie, biblionomie, bibliognomie, etc. - a commencé à désigner la science du livre (commerce du livre, activité d'information). Selon K.R.Simon, le mot "bibliographie" pourrait soit être emprunté à l'expérience existante, soit être inventé à nouveau sur le modèle de noms de sciences similaires (par exemple, la géographie). La palme en la matière appartient aux scientifiques français. C'est dans l'interprétation française que la bibliographie comme science est apparue en Russie au début du XIXe siècle.
Il convient de noter ici que les scientifiques russes ont non seulement emprunté les bases de la science bibliographique, mais, s'appuyant sur leur expérience historique séculaire, ont apporté beaucoup d'originalité. Et nous n'avons qu'à regretter que de nombreuses réalisations de l'histoire de la bibliographie russe soient soit insuffisamment étudiées, soit simplement ignorées au profit de constructions pseudo-scientifiques indépendantes.
L'innovation particulière de la bibliographie russe s'est manifestée dans ce qui suit troisième période son développement au début du 20ème siècle. Les bibliographes russes dans leurs développements scientifiques étaient désormais à égalité avec ceux de l'Europe occidentale et, par conséquent, du monde entier. Il suffit de se référer à Participation russe dans les travaux de l'Institut bibliographique international de Bruxelles, sur la concordance des idées de N.M. Lisovsky, A.M. Lovyagin et N.A. Rubakin avec les idées de P. Otlet (l'un des fondateurs de l'institut nommé). De plus, nos scientifiques étaient à bien des égards, en particulier théoriques, en avance sur les chercheurs étrangers.
La plus importante des réalisations nationales de la période considérée est que le rôle spécifique de la bibliographie en tant qu'activité dans un système plus large d'activité d'information (science du livre, documentation) et de la bibliographie en tant que science - dans le système de la science du livre (science du document sciences, informatique, etc.). En particulier, la réduction notoire de la bibliographie à la description de livres a commencé à se survivre. Cela a été particulièrement facilité par l'interprétation des soi-disant types de bibliographie proposés par N.A. Rubakin, puis N.V. Zdobnov. Méthodologiquement, cela a été montré dans les travaux de A.M. Lovyagin, qui sont encore étouffés - délibérément ou par ignorance. Et il a développé, parmi beaucoup d'autres, les deux idées suivantes, pourrait-on dire, remarquables. Le premier concerne la définition de la bibliographie (science du livre) comme science de la communication humaine, c'est-à-dire sur le commerce du livre, l'activité d'information, la communication. La seconde est liée à l'usage et à la concrétisation par rapport aux problèmes de bibliographie d'une méthode aussi dialectique que la remontée de l'abstrait au concret. Contrairement à l'approche technocratique de NM Lisovsky ("production de livres - distribution de livres - description de livre, ou bibliographie"), AM Lovyagin a interprété la communication de l'information comme une ascension, comme une réduction méthodologique de la description à l'analyse, et de celle-ci à la synthèse (rappel la formule hégélienne « thèse - antithèse - synthèse »). De plus, la bibliographie occupe ici une position médiane, puisque la synthèse de ses résultats, leur élévation au niveau culturel général, n'est possible qu'à travers la méthodologie d'une science plus générale - la science du livre (ou la désormais possible science plus large de l'activité informationnelle). Et la place médiane et centrale de la bibliographie ici ne peut être considérée comme accidentelle, puisque la communication de l'information est un processus dialectique avec retour d'information, quand, selon les vues du même A.M. Lovyagin, un renouveau constant est nécessaire - en soi mort - la culture du papier, i. l'introduction à chaque tour dialectique de l'activité d'information de tous les plus précieux, socialement significatifs dans le développement culturel et historique de la société. A cet égard, il est à noter que P. Otlet est allé encore plus loin dans ses constructions théoriques, considérant la bibliographie comme une métascience par rapport à la documentation, c'est-à-dire système de toutes les sciences du cycle de l'information et de la communication.
En vérité, la troisième période du développement de la bibliographie a été son âge d'or. Malheureusement, nous n'utilisons pas encore assez ses innovations. Pendant ce temps, les idées de A.M. Lovyagin et N.A. Rubakin ont été développées plus avant dans les œuvres de M.N. Kufaev, mais son héritage créatif n'a pas été suffisamment étudié et n'est pas utilisé.
vécu par nous moderne, quatrième de suite, période dans le développement de la bibliographie remonte approximativement aux années 60, lorsque la prochaine révolution scientifique et technologique a commencé, associée à l'introduction d'une nouvelle technologie de l'information (informatisation), et de telles nouvelles orientations scientifiques comme la cybernétique, la théorie de l'information, l'informatique, la sémiotique, etc. De nouveaux principes scientifiques, par exemple, les activités et la cohérence, ont également été étayés plus profondément. C'est en accord avec le principe d'activité qu'une nouvelle interprétation a commencé à être donnée à la structure typique de l'activité humaine en général et de l'édition de livres (activité d'information) en particulier, où la bibliographie, comme nous l'avons déjà noté, est corrélée avec une partie intégrante de tout type d'activité sociale comme la gestion, plus précisément - la gestion de l'information.
C'est au stade actuel et uniquement dans notre pays que un nouveau concept pour désigner la science de la bibliographie - "science bibliographique". Elle a été proposée pour la première fois en 1948 par I.G. Markov, qui, cependant, comprenait la bibliographie et sa science de manière trop étroite et pragmatique : « La bibliographie, ce sont des index et des ouvrages de référence qui ont pour objet des livres, et la science bibliographique est la théorie de la création, de la conception. et l'utilisation des index bibliographiques" [Sur le sujet et la méthode de bibliographie / / Tr. / Mosk. Etat biblique en-t. 1948. Numéro. 4. Art. 110]. La nouvelle désignation de science bibliographique a été incluse dans GOST 16448-70 "Bibliographie. Termes et définitions", également introduite pour la première fois dans la pratique mondiale. Ensuite, le terme "science bibliographique" a été répété dans la nouvelle édition du document normatif spécifié - GOST 7.0-77. Mais, malheureusement, le nouveau nom de science bibliographique était absent de la nouvelle édition - GOST 7.0-84. Mais, comme on le sait, le premier manuel universitaire a été publié sous le titre suivant : « Études bibliographiques. Cours général ».
De nouvelles discussions et approches sont possibles. Il est important de souligner que donner à la bibliographie une fonction de gestion en tant que spécificité de son rôle public dans l'activité d'information est considéré comme une tendance déterminante tout au long de son histoire dans notre pays (V.G. Anastasevich, M.L. Mikhailov, A.N. Soloviev). Mais pour une raison quelconque, peu d'importance est encore attachée à cela, il n'est tout simplement pas pris en compte dans les constructions conceptuelles de la bibliographie et de la science à ce sujet maintenant proposée. Mais il n'y a pas d'autre alternative. De plus, c'est la fonction de gestion de l'information qui distingue à la fois le passé et pratique moderne bibliographie. Par exemple, la tâche de "guider la lecture" est inscrite sur la bannière de l'un des domaines fonctionnels de la bibliographie - recommandation. Le sous-système bibliographique avec une fonction de contrôle déterminante est caractéristique, comme nous l'avons déjà noté, pour l'appareil d'un livre traditionnel ; de plus, il devient une partie spécifique des systèmes d'information automatisés (SIA) modernes - toutes sortes de SI, BD, KB, ES, IA, etc.
Ainsi, sur la base de la détermination des caractéristiques de l'émergence et du développement de la bibliographie et de la bibliographie, nous pouvons supposer que l'essence déterminante de cette branche spécifique de l'activité d'information est la gestion de l'information.
Un trait caractéristique de la bibliographie domestique moderne est sa diversité conceptuelle inhabituelle. Dans ce document, loin d'être toujours pacifiquement, différentes idées théoriques sur l'essence (la nature) de la bibliographie en tant que phénomène social coexistent, c'est-à-dire différents concepts et approches bibliographiques générales.
Considérons seulement quelques-uns des concepts les plus significatifs de ce genre, qui ont reçu la plus grande renommée et reconnaissance parmi les spécialistes. Ce sont, tout d'abord, trois concepts interconnectés, qui reposent sur la même caractéristique (mais comprise différemment) : l'objet de la bibliographie et le métasystème correspondant à cet objet, dans lequel la bibliographie est directement incluse en tant que sous-système.
Tout d'abord, l'origine historique concept de science du livre, selon laquelle la bibliographie a longtemps été considérée comme la science du livre, qui est une partie descriptive de la science du livre.
La vision de la bibliographie en tant que discipline scientifique bibliographique extensive est historiquement apparue dans les travaux des premiers théoriciens bibliographiques d'Europe occidentale de la fin du XVIIIe et du début du XXe siècle : M. Denis, Zh.F. Ne de la Rochelle, G. Grégoire, A.G. Camus, G. Peño, F.A. Ebert et autres.
En Russie dans le premier quart du XIXe siècle, grâce aux travaux d'éminents représentants de la pensée bibliographique russe V.G. Anastasevich et V.S. Sopikov, un point de vue s'est formé selon lequel la bibliographie en tant que science du livre était également identifiée à la science du livre au sens large.
Tout au long du 19ème siècle Les idées théoriques des bibliographes d'Europe occidentale et de Russie, qui s'influencent mutuellement et se différencient progressivement, se sont développées dans un même canal bibliographique.
Au tournant des XIX et XX siècles. en Russie, principalement dans les travaux d'un éminent bibliologue et bibliographe, le premier professeur de bibliologie à St. Lisovsky (1845 - 1920), une nouvelle idée de la bibliographie se forme progressivement en tant que discipline scientifique non identique à la bibliologie, mais ne constituant que sa partie indépendante (descriptive).
La position académique de la science exhaustivement descriptive de la bibliographie occupait une position dominante dans la Russie pré-révolutionnaire, mais n'a jamais été universellement reconnue. Elle a connu une opposition particulièrement sérieuse à propos de l'émergence d'une direction démocratique recommandatoire et pédagogique de l'activité bibliographique, orientée vers le lecteur populaire. La bibliographie s'est progressivement impliquée dans la sphère complexe de la lutte sociale, qui s'est notamment exprimée dans l'apparition des premières pousses de la social-démocratie, puis de la tendance bolchevique de la bibliographie.
Les désaccords entre représentants de divers courants idéologiques dans le cadre du concept de science du livre de la bibliographie se sont particulièrement aggravés dans les premières années du pouvoir soviétique, ce qui s'expliquait par la résistance que les représentants de l'école descriptive traditionnelle opposaient aux tendances associées à l'implication de bibliographie dans la résolution de tâches pratiques éducatives, éducatives, économiques et autres, avec la formulation de la question de la classe, l'approche du parti sur le contenu et les tâches de l'activité bibliographique.
Dans l'aspect théorique et conceptuel général considéré ici, le concept bibliographique de bibliographie en Union soviétique a évolué dans deux directions principales. Il s'agit, d'une part, d'un élargissement progressif de l'éventail des objets « livres » de l'activité bibliographique et, d'autre part, d'un rejet de plus en plus résolu de la qualification univoque de la bibliographie comme discipline scientifique au profit de représentations combinées reflétant à la fois les composantes scientifiques et pratiques de la bibliographie. bibliographie. Confirmons ce qui a été dit par des exemples.
Dans le premier sens. Dans les années 1920, le célèbre théoricien de la bibliothéconomie et de la bibliographie K.N. Derounov (1866 - 1929). Il a vivement condamné "le mélange catégorique de la bibliographie avec une décharge, où, avec des livres, des manuscrits anciens et des réimpressions imprimées d'articles de journaux, des listes de prix du commerce et des notes de musique, des pièces de monnaie et des médailles sont jetées en un seul tas ...".
La rigidité excessive de ces restrictions, excluant du champ de la bibliographie même les réimpressions d'articles de journaux et d'éditions musicales, avec pointe moderne la vue est tout à fait évidente.
Un peu plus tard, l'un des représentants les plus éminents de la science et de la pratique bibliographiques russes, N.N. Zdobnov (1888 - 1942) a défendu l'exclusion des manuscrits de l'objet de la bibliographie, estimant que le moment était venu "de séparer la description des ouvrages imprimés de la description des manuscrits, car il y a trop peu de points communs entre les deux descriptions". La bibliographie traite de la description des ouvrages imprimés ( livre manuscrit n'a fait l'objet de bibliographie qu'avant l'invention de l'imprimerie), et la description des manuscrits - l'archéographie.
À l'avenir, l'objet bibliographique de la bibliographie de K.R. Simon (1887 - 1966) et d'autres éminents représentants de la bibliographie russe.
Dans le deuxième sens. En 1936, dans un rapport à la Conférence panrusse sur questions théoriques la bibliothéconomie et la bibliographie est l'une des plus représentants éminentsécole nationale de bibliographie L.N. Tropovsky (1885 - 1944), ayant défini la bibliographie comme "un domaine de connaissance et d'activité scientifique et de propagande", a pour la première fois reflété dans une définition les caractéristiques de la bibliographie en tant que science et en tant qu'activité pratique.
Un trait caractéristique des vues de L.N. Tropovsky est que, reconnaissant traditionnellement la bibliographie comme une science, il en a transféré le centre de gravité à ses aspects pratiques de propagande. Il a insisté avec beaucoup d'insistance sur le caractère purement pratique, appliqué, de service de l'activité bibliographique. Cela a conduit à une certaine sous-estimation de L.N. Tropovsky de la théorie de la bibliographie, qu'il identifiait à une méthodologie spécifique, et tout ce qui allait au-delà de celle-ci, il l'appelait « détritus de la scolastique ».
Il est également intéressant que, tout en restant sur les positions de l'approche bibliologique, L.N. Tropovsky n'a pas associé son idée générale de la bibliographie à la science du livre, car il était généralement opposé à la science du livre en tant que science de principe.
Le concept de science du livre de la bibliographie a reçu la forme moderne la plus complète dans les travaux du célèbre bibliographe A.I. Blaireau (1918 - 1984). C'est à lui qu'on attribue le développement de la version moderne "non bibliographique" du concept, qui distingue clairement la bibliographie comme domaine d'activités scientifiques et pratiques pour la préparation et la communication de l'information bibliographique aux consommateurs et la science bibliographique. comme une science de la bibliographie qui développe des questions de théorie, d'histoire, d'organisation et de méthodologie des activités bibliographiques. Dans le même temps, la bibliographie a été examinée par A.I. Barsuk dans le cadre de l'industrie du livre, le système du « livre dans la société » et la bibliographie dans le cadre de la science du livre, qui ne fait pas partie de la bibliographie. Ce point de vue est encore partagé aujourd'hui par de nombreux représentants de la bibliologie nationale.
De plus, A.I. Barsuk a tenté de justifier la vision la plus large de l'objet livre de la bibliographie dans le cadre de l'approche de la science du livre. Il considérait que "livre", "littérature" est "tout ensemble d'œuvres d'écriture (quelles qu'en soient la nature, la forme, le mode de fixation), reproduites (ou destinées à être reproduites) de quelque manière que ce soit propre à la perception". Une telle approche rend la notion de « livre » très floue, mais elle rapproche les concepts bibliographiques et documentaires de la bibliographie.
Ainsi, tous les concepts théoriques de bibliographie qui ont surgi sur la base de l'approche bibliologique, malgré leurs différences internes très importantes, sont unis par un caractéristique commune- restriction de la composition des objets documentaires de la bibliographie sur la base de concepts tels que « livre », « ouvrage imprimé », « publication », « ouvrage d'écriture », « littérature ». C'est ce qui permet de qualifier tous ces concepts de concepts bibliologiques.
En deuxième, concept documentographique, qui est historiquement une continuation directe et un développement de la science du livre. Sur une nouvelle base conceptuelle et méthodologique, elle a été proposée et étayée dans la bibliographie domestique des années 70. Accueil elle caractéristique– un refus fondamental de toute restriction des objets documentaires de l'activité bibliographique quant à leur forme, leur contenu ou leur finalité. C'est pourquoi les tenants de l'approche documentographique opèrent avec les notions plus larges de « document » et de « système de communication documentaire » par rapport à « livre » et « métier du livre », désignant respectivement l'objet de la bibliographie et le métasystème de la bibliographie. (ces concepts sont examinés plus en détail dans le deuxième chapitre).
Il convient de noter que toute restriction sur l'objet de l'activité bibliographique dans le cadre de l'approche bibliographique est généralement accompagnée d'arguments historiques spécifiques et semble donc très convaincante (voir, par exemple, les considérations ci-dessus de N.V. Zdobnov). Cependant, c'est une fausse impression. En fait, c'est l'approche historique concrète qui démontre clairement que la bibliographie, par essence, a toujours été indifférente aux changements dans les formes de fixation et de diffusion des savoirs. Bien sûr, à un moment historique donné, il peut reconnaître telle ou telle forme de fixation de l'information comme la principale, la plus importante pour lui-même, mais il ne peut une fois pour toutes limiter son objet à une forme spécifique. Ainsi, par exemple, si nous affirmons que l'objet principal de l'activité bibliographique est un livre imprimé, alors il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'un livre est une œuvre imprimée, mais parce que ce sont précisément les œuvres imprimées qui sont historiquement devenues principal moyen d'enregistrement, de diffusion et d'utilisation des informations sociales.
La bibliographie a toujours traité de manière prédominante les formes qui sont devenues dominantes à une époque historique donnée, et a accordé beaucoup moins d'attention aux formes en voie de disparition ou à peine émergentes (mais ne les a jamais complètement exclues de son objet). Et il en sera toujours ainsi. Par conséquent, il est fondamentalement erroné de limiter généralement l'objet de l'activité bibliographique à une seule forme historiquement éphémère, par exemple, des œuvres imprimées ou même des œuvres écrites. Les règles de description bibliographique, les méthodes de caractérisation bibliographique peuvent changer avec le changement de forme des objets de l'activité bibliographique, mais l'essence sociale de la bibliographie en tant qu'intermédiaire, lien entre un document et une personne, en principe, restera inchangée .
Les partisans du concept bibliographique de bibliographie sont généralement déconcertés par le sens trop large du terme «document», en raison duquel, par exemple, les timbres-poste, les billets de banque, les en-têtes officiels, les tickets de tramway, les inscriptions sur les pierres tombales, etc., relèvent de la composition de l'objet de l'activité bibliographique, parfois comme une manifestation de formalisme de la part des représentants du concept documentographique, leur sous-estimation de la valeur idéologique, scientifique, artistique du « livre » comme objet principal de l'activité bibliographique.
Comme on l'a déjà noté, personne ne nie que le livre au sens le plus large, c'est-à-dire l'œuvre imprimée, soit aujourd'hui l'objet prédominant, principal de l'activité bibliographique. De plus, d'un point de vue strictement scientifique, la sémantique large du terme « document » n'a rien de dangereux pour la science et la pratique bibliographiques.
Il convient de souligner que dans le cadre de l'approche documentographique, une seule limitation de la composition des objets documentaires de l'activité bibliographique est reconnue : la signification sociale de l'information qu'ils contiennent. La signification sociale d'un document est un concept historique concret. Il ne peut y avoir de recettes adaptées à toutes les époques et à toutes les circonstances. Les gens eux-mêmes créent des informations documentées et, dans chaque cas, décident eux-mêmes s'il est d'un intérêt public suffisant pour faire l'objet d'une bibliographie ou non. En particulier, les inscriptions sur les pierres tombales sont bibliographiées depuis longtemps (pas toutes, bien sûr, mais celles qui appartiennent à des personnalités marquantes et acquièrent donc une importance sociale incontestable). Les timbres-poste et les billets de banque, si nous les considérons non pas du point de vue de leur destination et de leur fonctionnement immédiats, mais en tant que monuments de la culture matérielle et spirituelle, en tant qu'objets d'étude, objets de collection, etc., entrent également dans la catégorie des documents socialement significatifs. et devenir l'objet d'une bibliographie. Une situation similaire n'est pas exclue en principe en ce qui concerne les formulaires et les tickets de tram.
Le terme « bibliographie » dans le cadre du concept documentographique recouvre la science et la pratique bibliographiques, c'est-à-dire qu'il combine système unique activité bibliographique pratique et science bibliographique - la science de cette activité.
Il est clair que différentes idées sur les limites, la composition et les tâches de l'activité bibliographique, sur la structure générale de la bibliographie en tant que phénomène social découlent des approches bibliographique et documentographique. Cependant, il faut bien comprendre que les approches considérées sont corrélées entre elles comme étant plus étroites et plus larges. Il n'y a pas d'autres différences fondamentales entre eux. En d'autres termes, l'approche documentographique (au sens large) ne s'oppose pas à l'approche bibliographique, comme le croient parfois certains représentants de cette dernière, mais l'inclut comme un cas particulier avec toute la richesse de son contenu spécifique, sans renier ses acquis, importance et possibilités.
L'approche documentographique repose sur le fait immuable et tout à fait objectif de la fragmentation organisationnelle de l'activité bibliographique, de son implication organique dans diverses institutions publiques institutionnalisées du système de communication documentaire, c'est-à-dire en bibliothèque, rédaction, édition, archivage, commerce du livre, dans l'activité scientifique et d'information. Dans ces établissements publics, l'activité bibliographique s'exerce sous des formes propres à chacun d'entre eux.
Le concept documentographique embrasse, combine théoriquement en un système unique tous les modes d'existence de la bibliographie, y compris ceux qui se trouvent en dehors des nommés. institutions publiques. Cela seul montre que l'approche documentographique ne contredit pas l'approche bibliographique, ne nie pas l'existence de la bibliographie en tant que partie du commerce du livre, mais l'inclut comme sa composante importante et nécessaire. D'autre part, ce n'est que dans le cadre de l'approche documentographique que les limites du concept de bibliographie de bibliographie peuvent être correctement appréhendées et que les limites de ses possibilités explicatives (théoriques) et transformatrices (pratiques) peuvent être correctement appréciées.
En terminant la caractérisation du concept documentographique, il est nécessaire de distinguer et de souligner l'essentiel : le nom « documentographique » ne reflète pas tout à fait adéquatement son contenu réel. Elle n'est « documentographique » que dans un certain sens étroit, associée au document comme objet direct de bibliographie. Avec une qualification générale plus large et donc plus correcte, c'est système-activité, concept d'information-documentaire du début de la théorie générale de la bibliographie. Il est souhaitable qu'il soit considéré et évalué par des critiques respectés à ce titre.
Historiquement, le dernier idéographique ou notion d'infographie bibliographie, proposée et très minutieusement développée et argumentée par N.A. Slyadneva.
Il s'agit sans doute de la conception la plus exotique, la plus radicale, selon laquelle l'objet de la bibliographie est tout objet informationnel (« informoquants »), à la fois figé sous forme de documents (textes, ouvrages, publications, etc.) et non figé (faits , des idées , des fragments de connaissance en tant que tels, ainsi que des pensées, des sentiments, voire des prémonitions). Le métasystème de la bibliographie est l'univers entier de l'activité humaine (UHA), et la bibliographie elle-même se qualifie comme une branche méthodologique universelle et pénétrante (science) telle que les statistiques, les mathématiques, la logique, etc.
Il est facile de voir que la relation entre ces trois concepts ressemble à une poupée gigogne : chaque concept suivant inclut le précédent comme un cas particulier. À cet égard, un problème terminologique complexe se pose : est-il juste de supposer que les trois concepts concernent la bibliographie ?
Si l'on part du sens exact du terme « bibliographie », alors son usage n'est absolument légitime que dans le cadre du concept de science du livre. C'est ici que la « bibliographie » apparaît dans son sens propre, historiquement original.
Dans le deuxième concept, on ne parle plus en réalité de bibliographie, mais de documentographie. Cependant, force est de constater que dans les deux cas les bibliographes traitent d'objets bibliographiques fondamentalement homogènes, puisque les livres (œuvres écrites et imprimées) sont aussi des documents. Par conséquent, dans les deux concepts, l'objet de la bibliographie est un document. La seule différence est que dans le premier cas, il s'agit d'un certain type de documents et dans le second, de n'importe quel document.
Sur cette base, on peut affirmer que, dans le cadre du concept documentographique, il est tout à fait légitime d'utiliser la terminologie bibliographique traditionnelle, c'est-à-dire le terme familier de « bibliographie » et tous ses dérivés. Surtout si l'on considère que la transition de toute une industrie vers nouvelle terminologie(même si une telle transition est souhaitable en principe) est une entreprise complexe, coûteuse, associée à une longue rupture et un dépassement des traditions terminologiques historiquement établies, et donc difficile à mettre en œuvre. Le jeu en vaut-il la chandelle ? La question dans ce cas est très pertinente.
La relation entre les deux premiers et le troisième, le concept idéographique, est complètement différente. Ici la bibliographie est portée bien au-delà des limites du système des communications documentaires et on lui attribue de tels attributs idéographiques qui n'ont jamais fait et ne feront jamais l'objet d'une description bibliographique. En d'autres termes, nous ne parlons pas ici de bibliographie, plus précisément, pas seulement de bibliographie.
Parfois, un concept idéographique est appelé idéodocumentographique. Une formulation très significative, qui révèle bien que tout ce qui se cache derrière l'élément terme « documentographique » renvoie au concept documentographique, et ce qui se cache derrière l'élément terme « ideo » n'a rien à voir avec la bibliographie.
Il y a deux raisons principales qui ont poussé N.A. Slyadnev pour créer ce concept.
Tout d'abord, la volonté de favoriser une élévation du statut social, la valorisation de la bibliographie comme champ d'activité professionnelle dans le cadre d'une informatisation globale de la réalité environnante.
Deuxièmement, N.A. Slyadneva, en tant que représentante de la bibliographie sectorielle de la fiction, s'inquiète du "phénomène des formes d'information synthétiques et limites qui sont apparues à l'intersection des connaissances sectorielles et de la bibliographie".
Mais ces propriétés de l'information bibliographique sont connues depuis longtemps, puisqu'elle a toujours existé à la fois sous des formes indépendantes (aides bibliographiques) et sous forme de support bibliographique, c'est-à-dire d'éléments bibliographiques dans des sources d'information qui ne sont généralement pas bibliographiques. L'exemple le plus simple est l'information bibliographique sur les livres, à partir de laquelle le concept plus complexe de bibliographie affine s'est ensuite développé. Il en va de même pour les encyclopédies, les ouvrages de référence, les revues de résumés, etc., ainsi que pour les formes complexes modernes de produits bibliographiques de recommandation.
Toute la difficulté réside dans le fait que le degré et les formes de localisation de l'information bibliographique dans de telles sources sont différents. Dans certains cas, ils sont évidents (par exemple, dans la bibliographie des livres). Dans d'autres, l'information bibliographique n'est pas aussi clairement localisée et il n'est pas facile de déterminer où se termine l'information bibliographique et où commence l'information non bibliographique. Cela est particulièrement visible en ce qui concerne les grands et très grands systèmes d'information informatiques tels que nationaux (par exemple, le réseau informatique panrusse d'information et de bibliothèque LIBNET) ou mondiaux (par exemple, Internet). Mais c'est à cela que sert la théorie de la bibliographie, découvrir et expliquer ce qui est exactement bibliographique dans ces systèmes, et non pas essayer de les énumérer entièrement selon le département de bibliographie. Une telle approche en société (en dehors de la bibliographie) ne provoquera que la perplexité.
Dans la science de la bibliographie nationale, comme base pour la formation de concepts qui sont bibliographiques généraux selon la conception des auteurs, fondamentaux, supercomplexes dans les catégories de contenu ont longtemps été utilisés. culture Et connaissances.
Dans sa forme la plus générale, l'inclusion de la bibliographie (ainsi que d'autres domaines de la pratique sociale) dans la composition de la culture humaine est évidente. Il est plus difficile de trouver un objet social qui n'ait pas cette qualité. Par conséquent, la tentation à laquelle de nombreux bibliographes nationaux ont été soumis est tout à fait compréhensible, de voir l'essence originale de la bibliographie dans cette inclusion de celle-ci.
De nos jours notion culturelle la bibliographie sous sa forme la plus développée et la plus complète est présentée dans les ouvrages de M.G. Vokhrycheva.
Les principales dispositions du concept sous sa forme la plus générale sont les suivantes : l'objet de la bibliographie, ce sont les valeurs de la culture, le métasystème de la bibliographie, c'est la culture. En conséquence, la bibliographie, prise dans son ensemble, se définit comme une partie d'une culture qui assure, au moyen de moyens bibliographiques, la préservation et la transmission des valeurs documentées d'une culture de génération en génération.
Le lien direct de la bibliographie avec la catégorie du savoir est aussi évident que le lien avec la culture. Il n'y a donc rien d'étrange dans le désir des bibliographes de comprendre l'essence de la bibliographie en tant que phénomène social, en s'appuyant sur l'en deçà de celle-ci. La qualification générale de « connaissance » de la bibliographie a ses racines dans la bibliographie nationale dans le lointain passé pré-révolutionnaire.
Yu.S. Les dents. L'essence de son approche du problème de la relation entre connaissance et bibliographie est clairement exprimée dans le titre même de l'article « La bibliographie comme système de connaissance pliée ». L'article est riche d'idées fraîches pour l'époque, mais la thèse principale n'est pas suffisamment étayée. En particulier, il n'est pas tout à fait clair ce qu'est la « connaissance pliée » et quel type de connaissance est enroulé dans la description bibliographique. Les informations bibliographiques simplement transférées d'un document à sa description (auteur, titre, mentions légales, etc.) ne peuvent être considérées comme des connaissances écourtées.
Aujourd'hui, le principal représentant de la soi-disant concept cognitif (« connaissance ») La bibliographie est V.A. Fokeev. Bien sûr, en termes d'étendue de la couverture du matériel, de minutie et de profondeur du développement du sujet et de variété d'arguments, ses travaux ne peuvent être comparés à un petit article de Yu.S. Zubov.
Cependant, malgré l'ampleur impressionnante des recherches théoriques de V.A. Fokeev, on ne peut pas être d'accord avec tout dans ses écrits. Il y a suffisamment de points obscurs, contradictoires, controversés.
Ceci peut être illustré en citant quelques fragments petits mais très significatifs de l'un des derniers articles VIRGINIE. Fokeev "Concept noosphérique-culturologique (cognitographique) de bibliographie".
Voici les extraits :
1. « L'idée fondamentale du concept : la bibliographie est un complexe socioculturel, comprenant la connaissance bibliographique (l'information), l'institution sociale bibliographique et l'activité bibliographique… » (p. 218) ;
2. « Métasystème de bibliographie – noosphère… » (ibid.) ;
3. « L'objet direct de la bibliographie est un objet d'information (source de connaissance) de toute nature, un quantum (et en termes généraux, le monde) de la connaissance, fixé dans un texte, ou un texte et diverses formes de son existence : un document, un livre, une publication, un ouvrage, etc. (ibid.);
4. « L'essence de la bibliographie réside dans la connaissance bibliographique (KB), qui identifie les éléments de la noosphère et donne accès à la partie documentée de la noosphère…
La genèse de la bibliographie repose avant tout sur des facteurs biosociaux. BZ est un système de signes artificiels - un "amplificateur" d'un organe de réflexion aussi naturel que le cerveau » (pp. 218-219).
5. “Relations fondamentales dans le domaine de la bibliographie… Dans le système « texte fixe – humain », des relations de besoins au texte en tant que tel au niveau de son existence naissent légitimement.
Les relations bibliographiques sont principalement des correspondances sujet-sujet, des interactions du dialogue des cultures » (p. 219).
C'est assez. Maintenant un petit commentaire.
Sur le premier point. L'"idée fondamentale du concept" ne résiste pas à l'examen. Premièrement, une institution sociale bibliographique n'existe pas vraiment, puisque la bibliographie en tant que phénomène social n'a pas sa propre intégrité organisationnellement formalisée, et toute institution sociale n'est une « institution » que lorsqu'elle est institutionnalisée, c'est-à-dire d'abord organisationnellement formalisée. La particularité de la position de la bibliographie dans le système des communications documentaires réside dans le fait que la bibliographie (selon sa nature documentaire secondaire) se caractérise non pas par sa propre structure organisationnelle, mais par l'inclusion dans d'autres institutions sociales organisationnellement indépendantes - dans la bibliothéconomie, le livre commerce, archivage, etc. (voir § 2 du chapitre 9 à ce sujet).
Deuxièmement, même si l'on admet l'existence d'une institution sociale bibliographique, la liste proposée des trois composantes de la bibliographie est logiquement inacceptable. En fait, ces parties ne forment pas une « formule à trois angles » (p. 219), mais une poupée structurelle, dans laquelle la connaissance bibliographique est par conséquent une composante interne intégrale de l'activité bibliographique, qui à son tour (avec la bibliographie connaissance) fait certainement partie de la bibliographie reconnue comme institution sociale. De ce fait, il ne reste plus rien de « l'Idée Fondamentale du Concept », si ce n'est une institution sociale dont l'existence réelle est douteuse.
Enfin, troisièmement, il y a un autre défaut logique : la structure proposée est incomplète. Par exemple, où est la place de la bibliographie ? Probablement tous dans la même institution sociale.
Pour le deuxième point. Impliquer la noosphère dans le rôle d'un métasystème de bibliographie (c'est-à-dire un système lié par le contenu et le plus grand système le plus proche) est si artificiel qu'il ne nécessite pas d'objections détaillées. Qu'il suffise de rappeler ce qu'est la "noosphère".
En tant que réalité objective, la noosphère est « un nouvel état évolutif de la biosphère, dans lequel l'activité rationnelle de l'homme devient le facteur décisif de son développement ». "Au fur et à mesure que les progrès scientifiques progressent, l'humanité crée la noosphère comme un environnement spécial, qui comprend d'autres organismes et une partie importante du monde inorganique".
En tant que concept scientifique (qui plus est, en tant que catégorie philosophique), la noosphère « est utilisée dans certains concepts évolutifs pour décrire l'esprit comme un phénomène naturel particulier. D'une part, il (au concept de noosphère) est abordé par certains théologiens qui cherchent... à trouver une interprétation évolutive des dogmes de l'Église. D'autre part, ce concept est très populaire parmi les scientifiques traitant des problèmes d'interaction humaine avec l'environnement, en particulier des problèmes environnementaux.
Tout semble clair. L'inclusion de la bibliographie dans la noosphère est évidente dans la mesure où tout ce qui est d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement lié à l'activité de l'esprit humain sur la planète Terre, est inclus dans sa noosphère. Mais dès lors elle est loin de qualifier la noosphère de « métasystème » de la bibliographie au sens où ce concept est utilisé dans le cadre de l'approche systémique.
Pour le troisième point. Ce fragment, contenant la définition de l'objet de la bibliographie, est rempli d'erreurs logiques et de substitutions de concepts. Tout d'abord, "l'objet d'information" est introduit comme objet de la bibliographie. Entre parenthèses, il est précisé qu'il s'agit d'une « source de connaissances ». Cette source se transforme aussitôt en « quantum », et en termes généraux en « monde » de la connaissance elle-même. Pendant ce temps, la logique élémentaire suggère : si vous croyez que V.A. Fokeev et l'objet de la bibliographie est vraiment informatif, alors les « quanta » et les « mondes » d'information en découlent, et non la connaissance.
Puis du monde de la connaissance V.A. Fokeev revient sur le concept de « texte » et diverses formes de son existence. Voici les prochaines erreurs factuelles et logiques, puisque les "formes d'existence" réelles du texte sont orales, manuscrites, dactylographiées, imprimées, lisibles par machine, etc., et celles répertoriées par V.A. Fokeev "document, livre, publication, travail, etc." ce sont les « formes d'existence » du document. De plus, contrairement aux exigences de la logique, sur une ligne sont répertoriés - concept général« document » et ses propres « formes d'existence ».
En conséquence, si cette confusion est éliminée, alors sur la base du fragment ci-dessus, il n'est pas difficile de formuler une définition simple et claire : l'objet direct de la bibliographie est un document (en tant que source d'information) avec toute la variété des formes de son existence : livre, publication, ouvrage, etc.
Bien sûr, il convient de garder à l'esprit que cette définition manque du consommateur d'informations et de la relation "D - P" en tant que véritable objet direct de l'activité bibliographique.
Soit dit en passant, tout texte fixé sur n'importe quel support matériel est aussi l'une des « formes d'être » d'un document.
Sur le quatrième point. Ce fragment touche à deux questions très importantes - sur l'essence de la bibliographie et sur sa genèse. "L'essence de la bibliographie réside dans la connaissance bibliographique" - c'est tout à fait naturel (depuis le concept même de "savoir") et en même temps l'un des points les plus controversés de ce concept.
La nécessité du développement des connaissances dans le monde antique a conduit à l'invention de l'écriture, qui, à son tour, est devenue la raison et la condition de l'émergence d'un système de communications documentaires sur la scène historique. La bibliographie en est le produit inévitable et seul ce système et essence des phénomènes bibliographiques toujours dans ce système. était et est toujoursÀ nos jours documentaire secondaire.
En général, il semble que V.A. Fokeev a une pensée encline à métaphoriser la réalité qu'il étudie. « Quantum de la connaissance », « monde de la connaissance », « monde des textes », « monde des besoins en textes », « monde des communications textuelles », etc. Concepts-métaphores, beaux, mais sans réelle signification scientifique. La « noosphère » par rapport à la bibliographie est en fait aussi une métaphore. Ce qui vaut, par exemple, l'affirmation que le texte est le contenu de la noosphère. Ou qu'en est-il des connaissances bibliographiques, « identifiant les éléments de la noosphère » ? Et qu'est-ce que la « partie documentée de la noosphère » ? En termes de sens, c'est une telle partie qui est documentée, c'est-à-dire basée sur des documents, confirmée par des documents, mais ce sens ne correspond pas au contexte dans lequel il est placé en l'espèce. Dans ce contexte, la formulation « partie documentaire (probablement, plus précisément, aspect) de la noosphère » serait plus correcte. Mais alors il est logique de supposer que « l'aspect documentaire de la noosphère » est le « système de communications documentaires », qui agit comme un « métasystème » de bibliographie dans le concept documentographique.
Quant à la « genèse » de la bibliographie, l'affirmation selon laquelle elle « consiste principalement en des facteurs biosociaux » contredit le premier fragment, qui dit que la bibliographie est un complexe socioculturel, mais pas biosocial. Certes, déjà dans la phrase suivante, il s'avère ce qu'est un «facteur biosocial». Il s'avère que la connaissance bibliographique est un « amplificateur de cerveau » ! C'est vraiment quelque chose de nouveau dans la bibliographie théorique.
Sur le cinquième point. Nous parlons ici des principales relations dans le domaine de la bibliographie. À cet égard, revenons brièvement dans le passé. En 1996 V.A. Fokeev a déclaré: «En tant qu'objet de bibliographie, je décris le système« le monde des textes - le monde des besoins en textes », et non «le document - le consommateur», comme dans le concept documentographique». Cependant, le fragment de texte du cinquième paragraphe indique clairement qu'en fait, V.A. Fokeev lui-même n'est pas opposé à traiter de la relation «D-P», en la déguisant légèrement terminologiquement: au lieu d'un document, il y a un «texte fixe», et au lieu d'un consommateur d'informations, simplement «une personne».
Sinon, ce fragment est une illustration de l'obscurité. Qu'entend-on par « rapports d'exigence au texte en tant que tel au niveau de son existence » ? Ou comment comprendre que les relations bibliographiques sont des « correspondances sujet-sujet » et, en même temps, des « interactions du dialogue des cultures » ?
En terminant de nous familiariser avec le concept « cognitographique » de bibliographie, nous devons nous attarder sur un autre problème important et controversé. Il s'agit de sur la proposition de V.A. Fokeev de permuter en théorie les concepts « d'information bibliographique » et de « savoir bibliographique », c'est-à-dire de transférer du premier concept au second les fonctions du concept originel de la théorie générale de la bibliographie et le principe de distinguer les phénomènes bibliographiques des non-bibliographiques (pour ce principe, voir pp. 77 - 78)
Cette proposition découle assez logiquement du concept cognitographique de bibliographie, puisque le « savoir » y est constamment et consciemment donné. essentiel priorité sur "l'information".
Sans aucun doute, la solution de la question de la relation entre les concepts d'"information bibliographique" et de "connaissance bibliographique" dépend directement de la solution d'un problème plus général de la relation des catégories " information" Et " connaissances". Bien entendu, la solution de ce problème essentiellement philosophique n'est pas du ressort de la bibliographie. La tâche du bibliographe est de choisir correctement parmi les points de vue existants (et il y en a plus qu'assez dans la littérature spécialisée sur la philosophie et l'informatique) celui qui est le plus adéquat aux réalités bibliographiques et donc sera particulièrement productif « travailler » en science bibliographique.
Un tel point de vue existe. En principe, c'est très simple et convaincant. Son essence est que l'information est définie comme la seule forme (méthode, moyen) de transmission et/ou de perception des connaissances dans la société qui soit possible et accessible à une personne. Une forme plus courte de la définition est extrêmement simple : l'information est transmise et/ou la connaissance perçue.
Il est aisé de voir qu'une telle interprétation est très directement et fructueusement transférée à la science bibliographique : si l'information en général est transmise et/ou la connaissance perçue, alors l'information bibliographique est une connaissance bibliographique transmise et/ou perçue.
De ce qui précède, il s'ensuit qu'au sens le plus large (philosophique) du concept, information et connaissance sont liées en tant que forme et contenu.
Les connaissances (y compris les connaissances bibliographiques) en tant que telles (intransmissibles et incompréhensibles) existent soit dans le cerveau humain, soit sont conservées dans des fonds documentaires à l'état de stockage. Dès que ces connaissances commencent à être transmises et/ou perçues d'une manière ou d'une autre, elles deviennent des informations (y compris des informations bibliographiques). Ainsi, la connaissance a deux états principaux : du repos ou stockage (savoir en soi, incommunicable, conservé) et mouvements ou fonctionnement, c'est-à-dire transmission et perception (forme informationnelle de la connaissance).
En principe, les deux états ont la même importance, puisque l'un est impossible sans l'autre. Mais dans ce cas, dû principalement au concept cognitographique, le problème du choix s'est posé : quel état de connaissance - le premier ou le second - est pratiquement le plus important, le plus scientifiquement significatif, initialement le plus original pour la science et la pratique bibliographiques ? Il s'agit là d'une question fondamentale, dont dépend en réalité l'avenir de la bibliographie théorique.
Les concepts proposés par l'éminent scientifique de Saint-Pétersbourg A.V. Sokolov et par la suite presque oublié. Il s'agit d'une conception factuelle de l'information bibliographique et d'une interprétation de la nature de la bibliographie en tant que champ de production spirituelle.
Il n'est guère possible d'être d'accord avec le troisième d'affilée et le dernier dans le temps notion de communication UN V. Sokolov, qui repose sur un rejet complet du concept d'information (y compris l'information bibliographique), comme n'ayant aucun sens dans la réalité qui nous entoure. Il est proposé à l'échelle mondiale (notamment en bibliographie) de remplacer la notion d'"information" par la notion de "communication", bien qu'il soit bien évident que ces notions ne sont pas identiques dans leur contenu et donc l'une ne remplace pas l'autre [pour plus de détails sur ce concept, voir 37, 60] . Pour paraphraser un aphorisme bien connu, on peut dire que toute information est communication, mais toute communication n'est pas information.
Terminant la caractérisation de sa condition, il convient de souligner une idée qui échappe habituellement à l'attention de nombreux bibliographes. Tous les concepts ci-dessus et d'autres, selon les lois de la logique, ne se contredisent pas, car ils sont basés sur différents côtés(signes) de la réalité bibliographique. Ils sont tout à fait compatibles dans le cadre de l'ensemble de la bibliographie.
En attendant, c'est devenu presque un signe de bon goût, lors de la création d'un autre concept, de critiquer celui du documentaire. Bien qu'en réalité il n'y ait généralement pas de raison suffisante pour cela. Si, par exemple, nous examinons de près un concept culturologique ou cognitographique, nous constaterons que dans le premier l'objet de la bibliographie est les valeurs documentaires de la culture, et dans le second - la connaissance documentaire, c'est-à-dire dans les deux cas - les documents. Mais cela signifie que la bibliographie culturologique et la bibliographie cognitographique, simultanément et avec leur implication culturelle et savante, fonctionnent dans le système des communications documentaires. Il s'ensuit qu'à cet égard, les représentants de presque tous les concepts, en même temps, sont des représentants à part entière du concept documentographique. Peut-être que le concept de N.A. Slyadneva n'est qu'à moitié documentaire.
Ainsi, l'essentiel n'est pas qu'un documentaire ou tout autre concept soit meilleur ou pire que les autres, mais quel est leur rapport réel, comment et de quelle manière ils se complètent, et quel ensemble ils forment ensemble.
Dans l'une de ses œuvres, Valery Bryusov a écrit sur les mondes... où il y a cinq continents, Des arts, des connaissances, des guerres, des trônes Et quarante siècles ! La "mémoire des âges" de l'humanité est imprimée sur les pages des livres. Aujourd'hui, il existe de nombreux supports différents d'informations et de connaissances, mais le livre continue de jouer un rôle prédominant parmi eux. Comment "gérer" le patrimoine livresque ? - Cette question a longtemps inquiété les gens. Recueils compilés et anthologies les meilleures oeuvres et œuvres rassemblées. DANS Russie antique, par exemple, les gens du commerce du livre depuis le XIe siècle. ils ont commencé à composer et à réécrire des anthologies, appelées le beau mot volumineux "sélections".
Déjà dans le monde antique, les bibliothèques étaient si étendues que les préposés ne pouvaient pas se souvenir de tous les rouleaux de papyrus ou des tablettes d'argile qui y étaient stockés, leur nombre atteignait plusieurs milliers. Les inventaires des bibliothèques sont venus à la rescousse, qui, s'améliorant et se développant progressivement, se sont transformés en catalogues sur fiches modernes. Au fil du temps, des listes, des index, des critiques de livres et d'articles, de divers objectifs, sujets, volumes et formes, ont été ajoutés aux catalogues des bibliothèques. Toutes étaient généralement appelées bibliographies et, dans la terminologie moderne, ce sont des aides bibliographiques.
"Bibliographie" est un mot d'origine grecque ancienne. Littéralement, cela signifie "écriture". Vers le 5ème siècle avant JC.
en Grèce, les « bibliographes » ont commencé à désigner les personnes qui copiaient des livres.
Avec l'effondrement du monde antique, la culture du livre créée par lui a également péri, le mot "bibliographie" a disparu. On se souvient de lui peu de temps après l'invention de l'imprimerie, coïncidant avec le début de la Renaissance. Les imprimeurs étaient parfois appelés bibliographes. Et ce n'est que dans la première moitié du XVIIe siècle que les scientifiques français Gabriel Naudet et Louis Jacob ont utilisé pour la première fois le mot "bibliographie" dans le sens de : "liste de références". Puis il a acquis un sens plus large : "description de livre". Plus tard, au cours d'une longue pratique historique, l'usage du terme « bibliographie » a acquis les traits d'une ambiguïté prononcée. Cinq de ses sens les plus significatifs et les plus stables peuvent être distingués : 1) « bibliographie » en tant qu'ouvrage bibliographique distinct, Index bibliographique de la littérature ; 2) « bibliographie » comme ensemble d'ouvrages bibliographiques, sélectionnés selon un attribut ou une bibliographie de la presse périodique ; 3) la « bibliographie » en tant que science dont le sujet et les tâches ont été formulés différemment à des moments différents et par des auteurs différents ; 4) "bibliographie" comme domaine d'activités pratiques (ou scientifiques et pratiques) pour la préparation sources variées informations bibliographiques et services bibliographiques pour les consommateurs d'informations; 5) « bibliographie » en tant que concept collectif le plus large, qui comprend tout ce qui précède et tout autre phénomène bibliographique.
Les deux dernières définitions prévalent dans la science et la pratique bibliographiques modernes.
Au cours de la complication historique de l'activité bibliographique, ses tâches et fonctions, ses formes d'organisation et ses méthodes se diversifient de plus en plus, et dans les limites de l'activité bibliographique elle-même, le processus de division du travail commence inévitablement. On distingue deux processus principaux de l'activité bibliographique : la bibliographie et le service bibliographique.
Dans les deux premières normes de terminologie bibliographique (GOST 16418-70 et GOST 7.0-77), le terme "bibliographie" était utilisé pour désigner les activités bibliographiques pratiques.
En conséquence, les termes "bibliographie" et "activité bibliographique" se sont avérés synonymes. C'est en raison de cette identité des concepts de "bibliographie" et "activité bibliographique" que le deuxième terme a été exclu de GOST 7.0 - 77.
En attendant, le sens actif est bien mieux véhiculé par le terme "activité bibliographique".
L'actuel GOST 7.0 - 84 couvre la terminologie de base des activités bibliographiques pratiques. l'activité bibliographique elle-même y est définie comme "un champ d'activité d'information pour répondre aux besoins d'information bibliographique".
Ces dernières années, on a eu tendance à trouver une place logiquement justifiée au terme « bibliographie » dans le système de terminologie bibliographique. En ce sens, la « bibliographie » peut être définie comme un système d'activités diverses (pratique, recherche, enseignement, gestion) qui assure le fonctionnement de l'information bibliographique dans la société.
Ainsi, le terme « bibliographie », titre et unité du système de terminologie bibliographique, ne coïncide en sens avec aucun des éléments de ce système. En particulier, l'identité des concepts « bibliographie » et « activité bibliographique » est éliminée.
FORMES D'EXISTENCE DES INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES. DIVISION DES PRODUITS BIBLIOGRAPHIQUES PAR FORMES, TYPES, TYPES, GENRES.
Les formes d'existence de l'information bibliographique sont diverses et concrètement conditionnées historiquement. Dans toute cette diversité, il y a un point commun qui consiste, tout d'abord, dans le fait que la cellule élémentaire qui compose toute information bibliographique est un message bibliographique.
Un message bibliographique est formé à partir d'informations bibliographiques, c'est-à-dire des données sur le document bibliographique, qui sont extraites du document lui-même ou d'autres sources.
Informations bibliographiques uniquement matériel nécessaire pour la formation d'un message bibliographique.
Un message bibliographique est une entité structurelle intégrale composée d'informations bibliographiques, qui est un élément minimal et indivisible supplémentaire d'informations bibliographiques.
Les informations bibliographiques peuvent être transmises sous forme orale et documentée.
La communication bibliographique orale est largement utilisée dans la pratique bibliographique et bibliographique lors de l'émission de références bibliographiques orales, dans le cadre de l'information bibliographique des lecteurs, lors de la réalisation de revues et consultations bibliographiques orales, etc.
Un message bibliographique enregistré sous forme documentaire est appelé notice bibliographique.
La partie minimale requise d'une notice bibliographique est la description bibliographique du document.
Une description bibliographique, étant l'élément minimum nécessaire d'une notice bibliographique, c'est-à-dire d'un message bibliographique documenté est, par conséquent, un élément obligatoire et minimalement nécessaire de toute information bibliographique documentée.
Une notice bibliographique agit comme un élément d'un manuel bibliographique - le principal mode d'existence et le principal moyen de diffusion et d'utilisation de l'information bibliographique documentée. Un manuel bibliographique est un ensemble ordonné de notices bibliographiques unies par l'unité de l'idée, du but, de la forme et (ou) du contenu de l'information bibliographique contenue dans le manuel.
La notion d'"aide bibliographique" recouvre un très large éventail de modes d'existence documentés de l'information bibliographique. Toute information bibliographique enregistrée sous une forme documentaire finie est une aide bibliographique.
Dans la théorie de la bibliographie, en relation avec les aides bibliographiques, les principales catégories de classification suivantes sont utilisées : forme, type, genre, type.
Il existe les principales formes d'aides bibliographiques suivantes : publications bibliographiques - non périodiques, périodiques et continues ; formes d'édition non indépendantes (intra-livre, intra-magazine, intra-journal, livre, documents bibliographiques) ; - formulaires de cartes (classeurs); - les IPS bibliographiques (documentographiques) mécanisés et automatisés, y compris ceux mis en œuvre sur une base informatique ; Les principaux types d'aides bibliographiques sont considérés comme un index, une liste et une revue de la littérature.
Un index bibliographique est un manuel bibliographique qui a une structure complexe et est équipé d'un appareil auxiliaire.
Une liste bibliographique est un manuel bibliographique à structure fixe sans appareil auxiliaire.
Une revue bibliographique est un manuel bibliographique, qui est un récit cohérent sur des documents qui sont des objets de bibliographie.
Les types spéciaux de documents bibliographiques sont les index des éditions et les index auxiliaires des manuels bibliographiques.
1. Modèle théorique de bibliographie
La théorie est une reproduction mentale d'un objet (dans ce cas, une information bibliographique) et, surtout, son explication. savoir scientifique s'appuie sur la théorie. Des dizaines de livres et des centaines d'articles sont consacrés à la théorie de la bibliographie. La connaissance de la bibliographie commence d'abord par l'examen et la compréhension de son modèle théorique. Cette dernière est formée par une présentation de l'essence de la bibliographie et de ses appareil conceptuel, caractérisation de l'information bibliographique comme noyau de la bibliographie, ses propriétés, ses formes d'existence et ses fonctions, les principaux types d'information bibliographique, l'explication des liens systémiques de la bibliographie et son rôle dans le monde moderne.
Les premiers éléments d'information bibliographique sous forme de références à des livres anciens (poèmes épiques et chansons sur Gilgamesh, etc.) ont été trouvés par des scientifiques dans les textes de tablettes d'argile écrites au milieu du IIe millénaire av. et plus tard Ancien Orient. Ces éléments peuvent être qualifiés de proto-bibliographiques (du grec "protos" premier, primaire). Le mot "bibliographie" est venu aux langues européennes précisément de la Grèce antique. Dans les documents du Ve siècle. AVANT JC. les scribes étaient appelés bibliographes. Dès le début du 17ème siècle pendant plus de trois siècles suivants, il est utilisé dans le sens de ne pas "écrire", c'est-à-dire copier des livres; et dans l'autre - "description du livre". en Russie au XVIIIe siècle. il a été emprunté au français comme papier calque du mot « bibliographie ».
Le mot "bibliographie" est utilisé pour désigner toute liste de livres, revues, articles et autres documents. Cependant, à mesure que l'éventail des objets de réflexion bibliographique s'élargissait (en plus des livres, ils devenaient des magazines, des journaux, des articles et d'autres documents), le développement de l'activité bibliographique, l'évolution des idées sur la bibliographie conduisaient au fait que le nombre de les interprétations de son essence se sont multipliées. Selon A.I. Badger, le nombre de définitions bibliographiques était proche de 400. Le mot même "bibliographie" au milieu du XXe siècle. a été utilisé, tel qu'établi par I.I. Reshetinsky en dix sens. Les principales étaient au nombre de quatre : « description de livre et science à ce sujet », « liste de livres, revues, articles et autres ouvrages imprimés » qui composent la littérature scientifique, de fiction et autres (XIX-XX siècles), « le domaine de la activités scientifiques et pratiques "(proposé par L.N. Tropovsky en 1936), "discipline auxiliaire" (M.A. Briskman - p. 9 du manuel "Bibliographie générale", 1957). Le mérite des deux dernières définitions est la volonté d'établir des relations bibliographiques génériques. En d'autres termes, j'ai compris non seulement l'essence de la bibliographie, mais aussi de déterminer à quel phénomène social elle se réfère.
Et par la suite, les scientifiques ont cherché à établir des relations génériques de bibliographie. Cela s'appelait le domaine de la "culture" (B.Ya. Bukhshtab - 1961), "l'activité pratique" (I.I. Reshetinsky - 1969), "l'activité du livre" (A.I. Barsuk - 1975), "l'infrastructure cognitive de la communication du livre" (AV Sokolov - 2001). Dans diverses sources, la bibliographie était également appelée «scientifique-pratique et activité» (GOST 7.0-77), ou faisait référence à l'infrastructure du système de communication sociale »(Dictionnaire terminologique de la bibliothéconomie et des branches connexes du savoir. - 1995),« social système de communication » (Bibliothéconomie : Terminol.slov. - 1997). MG Vokhrysheva interprète la bibliographie comme un système qui organise « l'espace de l'information et du savoir.
Ces affirmations sont vraies dans la mesure où, par nature, la bibliographie fait partie de la culture, de l'économie, de l'éducation, de la science, des communications sociales, et plus encore de « l'espace d'information et de savoir » où les documents sont créés, déplacés et utilisés. Mais ils ne révèlent pas ses spécificités dans son ensemble. Ce dernier est matérialisé par sa composante principale - l'information bibliographique. Dans l'interprétation la plus générale, l'information bibliographique est une information sur des documents, la plupart du temps aliénés à ceux-ci. sur la base de cette interprétation. O.P. Korshunov a proposé de définir la bibliographie au sens le plus large - comme un système d'activités couvrant tous les phénomènes bibliographiques et assurant le fonctionnement de l'information bibliographique.
Ainsi, la compréhension scientifique moderne de la bibliographie est basée sur l'interprétation de son essence, le concept d '"information bibliographique" et sa référence à la sphère d'information de la société, mentionnée dans l'actuel GOST 7.0-99 Activités de bibliothèque et d'information, bibliographie comme "infrastructures d'information". Ce GOST définit l'infrastructure d'information comme un ensemble de centres d'information, de banques de données et de connaissances, de systèmes de communication qui permettent aux consommateurs d'accéder aux ressources d'information (terme 3.1.34). Il convient de préciser que le concept d '«infrastructure» désigne un sous-système auxiliaire de tout domaine d'activité sociale et assurant le fonctionnement du domaine d'activité. De ce point de vue, l'infrastructure de l'information est un système social qui organise la préparation et le fonctionnement de l'information sociale, et la bibliographie est son sous-système, qui a sa propre infrastructure.
Le caractère informatif de la bibliographie peut être considéré comme généralement reconnu. Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la définition suivante est proposée : La bibliographie est un système d'information sociale qui assure la préparation et le fonctionnement de l'information bibliographique.
Bibliographie à la Renaissance (fin XVIe-milieu XVIIIe siècles)
Au 5ème siècle, l'Église catholique a commencé à compiler des listes de livres interdits, ces listes ont ensuite été compilées sur les territoires des pays de confession orthodoxe. Comme je l'ai dit, en 1559, le premier ...
Bibliographie de l'histoire mondiale
bibliographie bibliographie alphabétique...
Pour comprendre l'essence de la bibliographie, les raisons de son émergence et les perspectives de développement futur, il est important de revenir à ses origines. Le mot « bibliographie » est d'origine grecque antique. Littéralement, cela signifie "écriture de livre" ("biblion" - un livre ...
L'histoire de l'émergence et du développement de la bibliographie
bibliographie information connaissance communication Fonctions publiques de la bibliographie, variété de leurs noms. Nous avons constaté que la bibliographie est une institution sociale...
L'histoire de l'émergence et du développement de la bibliographie
1. Correspondance de la bibliographie aux conditions économiques et socio-culturelles de la société. 2. La bibliographie ne perd rien de la valeur acquise au cours des années de son développement. 3...
Concepts culturels de la seconde moitié des XIXe et XXe siècles
Le culturologue et historien néerlandais J. Huizinga (1872-1945) a représenté la culture par le jeu. Dans les oeuvres "Automne du Moyen Age" (1919), "Homme jouant" (1938)...
La mentalité de la culture politique soviétique
Avant de procéder directement à l'étude de la mentalité politique, il est nécessaire de savoir ce que signifient les concepts mêmes de "mentalité" et de "mentalité"...
Traditions méthodologiques et innovation G.N. Gennadi et S.A. Vengerov dans la compilation de dictionnaires bibliographiques
La nature morte comme genre de peinture
Considérant le genre de nature morte, vous pouvez voir qu'il se distingue par ses principes particuliers. Une nature morte devient une œuvre d'art si l'artiste voit son intrigue, les traits de la composition de la forme, le jeu de couleurs...
jardin de roches
"droit">Les pierres m'ont appris le silence. "correct">Les pierres m'ont appris la patience. "correct">Les pierres m'ont appris le calme. "droit">Les pierres m'ont appris la contemplation. "bon">Les pierres m'ont appris l'infinité de l'univers...
Compilation d'une liste bibliographique annotée de références: une série de livres sur l'art de la maison d'édition "ART-RODNIK"
Culturellement et historiquement, le concept de "bibliographie" apparaît à un certain stade de la formation de l'activité d'information, lorsque le besoin d'un développement ciblé de cette sphère d'activité sociale la plus importante est réalisé...
L'essence et les fonctions du musée
Le résultat du travail effectué devrait être le contenu du site pour une vedette-matière donnée. Pour atteindre cet objectif, le contenu des sites a été analysé. Basé sur des données...