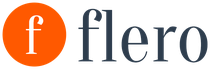" et "libéral" viennent du latin "liberalis" et signifient littéralement "avoir à la liberté". Lorsqu'il s'agit d'un libéral en tant que partisan d'un mouvement socio-politique, on suppose que cette personne se tient sur une plate-forme qui salue l'approfondissement et le développement des libertés politiques au sens le plus large du terme. En règle générale, l'idéologie libérale réunit les partisans du parlementarisme démocratique, ainsi que ceux qui défendent la liberté de l'entreprise privée.
Dans la vie de tous les jours, l'étiquette « libéral » est le plus souvent donnée à ceux qui font preuve d'une tolérance inutile et inappropriée pour le comportement d'autrui qui viole les normes et les règles généralement acceptées. On pense, par exemple, que l'éducation excessive de la jeune génération affecte négativement la formation de la personnalité d'un adolescent. Souvent, le public est tenu de mettre fin au libéralisme contre les criminels et les contrevenants malveillants aux normes sociales.
en politique
Qui peut être attribué aux libéraux dans le domaine d'activité ? Il s'agit deà propos de personnalités publiques qui soutiennent et approuvent pleinement l'idée de limiter toute ingérence des structures étatiques dans les relations sociales. Les grands principes du système de valeurs libéral ont été formés à l'époque où les relations bourgeoises basées sur la libre entreprise sont nées et se sont renforcées dans la société.
Le libéral considère la liberté personnelle, économique et politique comme la plus haute priorité dans la vie sociale et politique. Les droits et libertés pour un libéral deviennent une sorte de base et de point de départ pour la formation d'une position politique. Selon les politiciens libéraux, c'est le libre développement de toute société sociale qui permet de construire un État véritablement démocratique.
La démocratie libérale devient l'idéal de nombreux politiciens occidentaux. Cependant, aujourd'hui, il reste peu de l'ancienne libre-pensée et de la libre-pensée en elle. L'accent principal des libéraux occidentaux n'est pas tant mis sur l'expansion des libertés réelles des citoyens, mais sur la suppression des restrictions qui entravent le développement du secteur privé. Les politologues et les sociologues notent que les traditions occidentales pénètrent de plus en plus profondément dans l'économie, la politique et la culture des pays en développement.
Qu'est-ce que le libéralisme ? Chaque personne répondra différemment à cette question. Même les dictionnaires donnent différentes définitions de ce concept. Cet article explique ce qu'est le libéralisme, en mots simples.
Définitions
Plusieurs des plus définitions précises notion de libéralisme.
1. Idéologie, mouvement politique. Il rassemble des admirateurs du parlementarisme, des droits démocratiques et de la libre entreprise.
2. Théorie, un système d'idées politiques et philosophiques. Il a été formé parmi les penseurs d'Europe occidentale aux XVIIIe et XIXe siècles.
3. La vision du monde caractéristique des idéologues issus de la bourgeoisie industrielle, qui défendaient la liberté d'entreprendre et leurs droits politiques.
4. Au sens premier - libre-pensée.
5. Tolérance excessive, condescendance, attitude conciliante envers les mauvaises actions.
Parlant de ce qu'est le libéralisme, en termes simples, il convient de noter qu'il s'agit d'un mouvement politique et idéologique, dont les représentants nient les méthodes de lutte révolutionnaires pour obtenir certains droits et avantages, prônent la libre entreprise, la mise en œuvre des principes démocratiques.
Principes de base du libéralisme
L'idéologie du libéralisme diffère des autres théories de la pensée politique et philosophique par ses principes particuliers. Ils ont été formulés par des scientifiques aux XVIIIe et XIXe siècles, et les représentants de cette tendance s'efforcent toujours de leur donner vie.
1. La vie humaine est une valeur absolue.
2. Toutes les personnes sont égales entre elles.
3. La volonté de l'individu ne dépend pas de facteurs externes.
4. Les besoins d'une personne sont plus importants que le collectif. La catégorie « personnalité » est primaire, « société » est secondaire.
5. Toute personne a des droits naturels inaliénables.
6. L'État doit naître sur la base d'un consensus général.
7. L'homme lui-même crée des lois et des valeurs.
8. Le citoyen et l'État sont responsables l'un envers l'autre.
9. Séparation des pouvoirs. Dominance des principes du constitutionnalisme.
10. Le gouvernement doit être élu par le biais d'élections démocratiques équitables.
11. Tolérance et humanisme.
Idéologues du libéralisme classique
Chaque idéologue de ce mouvement comprenait à sa manière ce qu'était le libéralisme. Cette théorie est représentée par de nombreux concepts et opinions, qui peuvent parfois se contredire. Les origines du libéralisme classique se retrouvent dans les travaux de C. Montesquieu, A. Smith, J. Locke, J. Mill, T. Hobbes. Ce sont eux qui ont jeté les bases d'une nouvelle tendance. Les principes de base du libéralisme ont été développés au siècle des Lumières en France par C. Montesquieu. Il a parlé pour la première fois de la nécessité de la séparation des pouvoirs et de la reconnaissance de la liberté individuelle dans toutes les sphères de la vie.

Adam Smith a étayé ce qu'est le libéralisme économique et a également souligné ses principes et caractéristiques principaux. J. Locke est le fondateur de la théorie de la primauté du droit. De plus, il est l'un des idéologues les plus en vue du libéralisme. J. Locke a soutenu que la stabilité dans une société ne peut exister que si elle se compose de personnes libres.
Caractéristiques du libéralisme au sens classique
Les idéologues du libéralisme classique se sont concentrés sur le concept de « liberté individuelle ». Contrairement aux idées absolutistes, leurs concepts niaient la subordination complète de l'individu à la société et aux ordres sociaux. L'idéologie du libéralisme défendait l'indépendance et l'égalité de tous. La liberté était perçue comme l'absence de toute restriction ou interdiction à la mise en œuvre d'actions conscientes de l'individu dans le cadre de règles et de lois généralement acceptées. L'État, selon les pères du libéralisme classique, est tenu d'assurer l'égalité de tous les citoyens. Cependant, une personne doit s'inquiéter indépendamment de sa situation financière.

Le libéralisme a proclamé la nécessité de limiter la portée de l'État. Ses fonctions devraient être réduites au minimum et consister à maintenir l'ordre et à assurer la sécurité. Le pouvoir et la société ne peuvent exister qu'à la condition d'obéir aux lois.
Modèles du libéralisme classique
J. Locke, J.-J. Russo, J. St. Moulin, T. Payne. Ils ont défendu les idées d'individualisme et de liberté humaine. Pour comprendre ce qu'est le libéralisme au sens classique, il faut considérer ses interprétations.
- Modèle européen continental. Les représentants de cette conception (F. Guizot, B. Constant, J.-J. Rousseau, B. Spinoza) défendaient les idées du constructivisme, rationalisme en interaction avec le nationalisme, accordant plus d'importance à la liberté au sein de la société qu'au niveau des individus.
- Modèle anglo-saxon. Les représentants de ce concept (J. Locke, A. Smith, D. Hume) ont mis en avant les idées de l'État de droit, du commerce illimité, étaient convaincus que la liberté est plus importante pour un individu que pour la société dans son ensemble.
- Modèle nord-américain. Les représentants de ce concept (J. Adams, T. Jefferson) ont développé les idées de droits de l'homme inaliénables.
libéralisme économique
Cette direction du libéralisme reposait sur l'idée que les lois économiques fonctionnent de la même manière que les lois naturelles. L'intervention de l'État dans ce domaine a été jugée inacceptable.

A. Smith est considéré comme le père du concept de libéralisme économique. Son enseignement était basé sur les idées suivantes.
1. La meilleure incitation au développement économique est l'intérêt personnel.
2. Les mesures étatiques de régulation et de monopole, qui ont été pratiquées dans le cadre du mercantilisme, sont néfastes.
3. Le développement de l'économie est dirigé par une "main invisible". Les institutions nécessaires doivent naître naturellement sans ingérence de l'État. Les entreprises et les fournisseurs de ressources qui souhaitent accroître leur propre richesse et opèrent dans un système de marché concurrentiel sont prétendument dirigés par une « main invisible » qui contribue à la satisfaction des besoins sociaux.
Montée du néolibéralisme
Considérant ce qu'est le libéralisme, la définition doit être donnée à deux concepts - classique et moderne (nouveau).
Au début du XXe siècle. des phénomènes de crise commencent à apparaître dans ce sens de la pensée politique et économique. Des grèves ouvrières ont lieu dans de nombreux États d'Europe occidentale et la société industrielle entre dans une période de conflit. Dans ces conditions, la théorie classique du libéralisme cesse de coïncider avec la réalité. De nouvelles idées et principes se forment. Le problème central du libéralisme moderne est la question des garanties sociales des droits et libertés de l'individu. Cela a été largement facilité par la popularité du marxisme. De plus, la nécessité de mesures sociales a été envisagée dans les travaux de I. Kant, J. St. Moulin, G. Spencer.
Principes du (nouveau) libéralisme moderne
Le nouveau libéralisme se caractérise par une orientation vers le rationalisme et des réformes ciblées afin d'améliorer les systèmes étatiques et politiques existants. Une place particulière est occupée par le problème de la comparaison entre liberté, justice et égalité. Il y a le concept d'« élite ». Il est formé des membres les plus dignes du groupe. On croit que la société ne peut triompher que grâce à l'élite et meurt avec elle.
Les principes économiques du libéralisme sont définis par les concepts de "marché libre" et "d'Etat minimal". Le problème de la liberté acquiert une coloration intellectuelle et se traduit dans le domaine de la morale et de la culture.
Caractéristiques du néolibéralisme
En tant que philosophie sociale et concept politique, le libéralisme moderne a ses propres caractéristiques.
1. L'intervention de l'État dans l'économie est nécessaire. Le gouvernement doit protéger la liberté de concurrence et le marché de la possibilité d'un monopole.
2. Appui aux principes de démocratie et de justice. Les larges masses doivent participer activement au processus politique.
3. L'État est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes visant à soutenir les couches à faible revenu de la population.

Différences entre le libéralisme classique et moderne
idée, principe | libéralisme classique | néolibéralisme |
La liberté est... | Exemption des restrictions | La possibilité de développement personnel |
Droits humains naturels | L'égalité de tous, l'impossibilité de priver une personne de ses droits naturels | Attribution des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques de l'individu |
Élévation de la vie privée et son opposition à l'État, le pouvoir devrait être limité | Il est nécessaire de mener des réformes qui amélioreront la relation entre le citoyen et les autorités |
|
L'intervention de l'État dans le domaine social | Limité | Utile et indispensable |
L'histoire du développement du libéralisme russe
En Russie déjà au XVIe siècle. comprendre ce qu'est le libéralisme. Il y a plusieurs étapes dans l'histoire de son développement.
1. Libéralisme gouvernemental. Il est né dans les cercles les plus élevés de la société russe. La période du libéralisme gouvernemental coïncide avec le règne de Catherine II et d'Alexandre Ier. En fait, son existence et son développement couvrent l'ère de l'absolutisme éclairé.
2. Libéralisme post-réforme (conservateur). Représentants exceptionnels de cette époque étaient P. Struve, K. Kavelin, B. Chicherin et d'autres. Au même moment, le libéralisme zemstvo se formait en Russie.
3. Nouveau libéralisme (social). Les représentants de cette direction (N. Kareev, S. Gessen, M. Kovalevsky, S. Muromtsev, P. Milyukov) ont défendu l'idée de créer des conditions de vie décentes pour chaque personne. A ce stade, les conditions préalables à la formation du Parti des cadets ont été formées.
Ces tendances libérales différaient non seulement les unes des autres, mais présentaient également de nombreuses différences avec les concepts d'Europe occidentale.
Libéralisme gouvernemental
Nous avons examiné précédemment ce qu'est le libéralisme (définition en histoire et science politique, signes, traits). Cependant, des directions authentiques de cette tendance ont été formées en Russie. Un excellent exemple est le libéralisme gouvernemental. Il atteint l'apogée de son développement sous le règne d'Alexandre Ier. A cette époque, les idées libérales se répandent parmi la noblesse. Le règne du nouvel empereur a commencé par une série de changements progressifs. Il était autorisé à traverser librement la frontière, à importer des livres étrangers, etc. À l'initiative d'Alexandre Ier, un comité officieux a été créé, qui a participé à l'élaboration de projets de nouvelles réformes. Il se composait de proches collaborateurs de l'empereur. Les plans des dirigeants du Comité des silences comprenaient la réforme du système étatique, la création d'une constitution et même l'abolition du servage. Cependant, sous l'influence des forces réactionnaires, Alexandre Ier n'a décidé que des transformations partielles.

L'émergence du libéralisme conservateur en Russie
Le libéralisme conservateur était assez répandu en Angleterre et en France. En Russie, cette direction a pris des caractéristiques particulières. Le libéralisme conservateur prend son origine au moment de l'assassinat d'Alexandre II. Les réformes que l'empereur a développées n'ont été que partiellement mises en œuvre et le pays devait encore être réformé. L'émergence d'une nouvelle direction est due au fait que dans les cercles les plus élevés de la société russe, ils ont commencé à comprendre ce que sont le libéralisme et le conservatisme et ont essayé d'éviter leurs extrêmes.
Idéologues du libéralisme conservateur
Afin de comprendre ce qu'est le libéralisme post-réforme en Russie, il est nécessaire de considérer les concepts de ses idéologues.
K. Kavelin est le fondateur de l'approche conceptuelle de cette direction de la pensée politique. Son élève, B. Chicherin, a développé les fondements de la théorie du libéralisme conservateur. Il a défini cette direction comme « positive », dont le but est de mettre en œuvre les réformes nécessaires à la société. Dans le même temps, toutes les couches de la population doivent non seulement défendre leurs propres idées, mais aussi tenir compte des intérêts des autres. Selon B. Chicherin, une société ne peut être forte et stable que si elle est fondée sur le pouvoir. En même temps, une personne doit être libre, puisqu'elle est le commencement et la source de toutes les relations sociales.
Le développement des fondements philosophiques, culturels et méthodologiques de cette tendance a été réalisé par P. Struve. Il pensait que seule une combinaison rationnelle de conservatisme et de libéralisme pouvait sauver la Russie dans la période post-réforme.
Caractéristiques du libéralisme post-réforme
1. Reconnaissance de la nécessité d'une réglementation étatique. Dans le même temps, les directions de son activité doivent être clairement identifiées.
2. L'Etat est reconnu comme le garant de la stabilité des relations entre divers groupesà l'intérieur du pays.
3. La prise de conscience que pendant la période d'échecs croissants des réformateurs, il devient possible pour des dirigeants autoritaires d'accéder au pouvoir.
4. Les transformations de l'économie ne peuvent être que progressives. Les idéologues du libéralisme post-réforme soutenaient qu'il était nécessaire de surveiller la réaction de la société à chaque réforme et de les mener avec prudence.
5. Attitude sélective envers la société occidentale. Il faut utiliser et percevoir uniquement ce qui répond aux besoins de l'État.
Les idéologues de cette direction de la pensée politique ont cherché à incarner leurs idées à travers un appel aux valeurs de masse qui se sont formées au cours du développement historique de la société. C'est le but et caractéristique libéralisme conservateur.
Libéralisme de Zemsky
En parlant de la Russie post-réforme, il est impossible de ne pas mentionner ce qu'est le libéralisme zemstvo. Cette tendance est apparue à la fin du XIXe - début du XXe siècle. À cette époque, la Russie se modernisait, ce qui entraînait une augmentation du nombre d'intelligentsia, dans les cercles desquelles un mouvement d'opposition s'était formé. A Moscou, un cercle secret "Conversation" a été créé. C'est son travail qui a initié la formation des idées de l'opposition libérale. Les figures de Zemstvo F. Golovin, D. Shipov, D. Shakhovsky étaient membres de ce cercle. La revue Libération, publiée à l'étranger, devient le porte-parole de l'opposition libérale. Ses pages parlaient de la nécessité de renverser le pouvoir autocratique. En outre, l'opposition libérale a préconisé l'autonomisation des zemstvos, ainsi que leur participation active au gouvernement.
Nouveau libéralisme en Russie
Le courant libéral dans la pensée politique de la Russie acquiert de nouvelles caractéristiques au début du XXe siècle. La direction se forme dans un environnement de vive critique de la notion d'"Etat de droit". C'est pourquoi les libéraux se donnent pour tâche de justifier le rôle progressiste des institutions gouvernementales dans la vie de la société.
Il est important de noter qu'au XXe siècle. La Russie entre dans une période de crise sociale. Sa cause, les nouveaux libéraux ont vu le désordre économique habituel et la catastrophe spirituelle et morale. Ils croyaient qu'une personne devrait avoir non seulement des moyens de subsistance, mais aussi des loisirs, qu'elle utilisera pour son amélioration.
Libéralisme radical
Parlant de ce qu'est le libéralisme, il convient de noter l'existence de sa tendance radicale. En Russie, il a pris forme au début du XXe siècle. L'objectif principal de ce mouvement était le renversement de l'autocratie. Un exemple frappant des activités des libéraux radicaux était le Parti constitutionnel démocrate (les cadets). Compte tenu de cette orientation, il est nécessaire d'en souligner les principes.
1. Minimiser le rôle de l'État. Les espoirs reposent sur des processus spontanés.
2. Atteindre vos objectifs de différentes manières. La possibilité d'utiliser des méthodes coercitives n'est pas niée.
3. Dans le domaine économique, seules des macro-réformes rapides et profondes sont possibles couvrant autant d'aspects que possible.
4. L'une des principales valeurs du libéralisme radical est la combinaison de l'expérience de la culture mondiale et des États européens développés avec les problèmes de la Russie.

Libéralisme russe contemporain
Qu'est-ce que le libéralisme moderne en Russie ? Cette question est encore discutable. Les chercheurs ont proposé différentes versions sur l'origine de cette direction, sur ses principes et ses caractéristiques en Russie.
Les scientifiques identifient certaines caractéristiques du libéralisme moderne en Russie. Considérons-les plus en détail.
1. Raisonner sur le système politique va souvent au-delà du libéralisme.
2. Justification de la nécessité de l'existence d'une économie de marché.
3. Encouragement et protection des droits de propriété privée.
4. L'émergence de la question de "l'identité russe".
5. Dans le domaine de la religion, la plupart des libéraux sont en faveur d'une attitude tolérante envers les autres confessions.
résultats
Il existe aujourd'hui de nombreux courants dans le sens libéral de la pensée politique. Chacun d'eux a développé ses propres principes et particularités. Récemment, il y a eu un débat dans la communauté mondiale sur ce qu'est le libéralisme inné, s'il existe ou non. Il convient de noter que même les éclaireurs français ont soutenu que la liberté est un droit, mais tout le monde ne comprend pas sa nécessité.
En général, on peut dire que les idées libérales et les transformations font partie intégrante de la vie moderne.
Libéralisme
Dans son émergence et son développement, le libéralisme est passé par deux étapes :
1_17-19 siècle : libéralisme classique
2_du début du 20ème siècle à aujourd'hui: néolibéralisme ou libéralisme social
John Locke, Jean Jacques Rousseau (« Du contrat social »), John Stuart Mill (« De la liberté »), Thomas Paine (« Les droits de l'homme », « Le bon sens ») sont considérés comme les pères fondateurs de l'idéologie libérale. L'idéologie du libéralisme est l'idéologie du temps nouveau, quand le Moyen Age et le féodalisme s'estompent dans le passé et que le capitalisme se développe. Les principales idées du libéralisme classique :
1_Reconnaissance d'une personne comme valeur la plus élevée. Le libéralisme est l'idéologie de l'individualisme.
2_Reconnaissance de l'égalité de tous les peuples et reconnaissance de la personnalité naturelle d'une personne, acquise en vertu de la naissance de droits inaliénables (fondamentaux : le droit à la vie, à la propriété, à la liberté).
3_Reconnaissance de la liberté comme la plus haute des valeurs qu'une personne possède. En même temps, une personne est responsable de ses actes. L'unité de la liberté et de la responsabilité est l'une des pierres angulaires de l'idéologie libérale.
4_L'état de droit. Seule la loi peut limiter la liberté d'une personne.
5_Anti-étatisme - l'état aussi minimisé que possible.
6_Tolérance morale et religieuse.
7_Les relations entre la société et l'État ont un caractère contractuel.
8_La foi dans le progrès social.
9_Reconnaissance de la libre concurrence, de la libre entreprise privée et du marché comme régulateurs naturels des relations économiques et sociales.
L'étatisme est l'intervention active de l'État dans le domaine économique et vie politique des pays.
Les libéraux ont été confrontés à un certain nombre de problèmes : l'égalité des personnes, la libre entreprise et le marché peuvent réguler de nombreux, mais pas tous, d'autres régulateurs sont nécessaires, ce qui a entraîné une augmentation de l'État et de son rôle.
néolibéralisme
Au fil du temps, un certain nombre de dispositions du libéralisme classique ont été révisées et les idées néolibérales ont été principalement formulées après la Seconde Guerre mondiale.
En 1947, l'Internationale libérale est créée, qui réunit plus de 20 partis. Désormais, tous les pays d'Europe y sont présents.
Les théoriciens du néolibéralisme sont : Hayek, Bell, Toffler, Aron.
Les principales idées du néolibéralisme :
1_Améliorer l'efficacité de la production basée sur la haute technologie
2_L'outil principal est d'encourager la liberté de propriété privée et d'entrepreneuriat.
3_L'État devrait réduire sa participation directe à l'économie.
4_L'État devrait limiter ses fonctions sociales aux soins des personnes employées dans la production post-industrielle, c'est-à-dire qu'il ne devrait se soucier que du bien-être des deux tiers de la société, qui créent la richesse du pays.
5_Internationalisation de l'économie, développement et mise en œuvre de programmes d'intégration régionaux et mondiaux.
6_Prendre soin d'un environnement naturel favorable, développer des programmes environnementaux, résoudre des problèmes mondiaux.
L'essence des idées fondamentales de la social-démocratie
Les principales idées du socialisme démocratique, elles sont énoncées dans la Déclaration de principes de l'Internationale socialiste (1989)
L'interdépendance de la société et de l'individu
Démocratie politique :
Parlementarisme
Système multipartite
Reconnaissance de l'opposition
Le droit à la dissidence
Orientation vers un développement évolutif non violent
Démocratie économique, économie mixte
Les organisations et mouvements sociopolitiques, leur typologie et leurs fonctions
Les organisations et mouvements sociopolitiques sont des formations volontaires nées du libre arbitre de citoyens unis sur la base d'intérêts et d'objectifs communs.
Les partis sont également inclus dans ce groupe, mais se démarquent fortement. Seulement, ils ont fixé un objectif clair d'atteindre le pouvoir, l'utilisation du pouvoir. Seuls les partis ont une structure rigide et un schéma clair pour accéder au pouvoir. Autre organismes publics moins politisé.
Contrairement aux partis, ces mouvements et organisations ne mets pas le but est de s'emparer du pouvoir de l'État. Le nombre d'organisations et de mouvements sociopolitiques dépasse largement le nombre de partis.
Typologie des organisations et mouvements sociopolitiques
Par domaine d'activité :
1_RSPP - Union russe des industriels et entrepreneurs
2_syndicats
3_syndicats sportifs
4_unions et associations créatives
5_organisations de défense des droits humains
6_mouvements écologiques, etc.
Selon le degré et la forme d'organisation :
1_élémentaire
2_faiblement organisé
3_avec un haut degré d'organisation
Par durée de vie :
1_court terme
2_long terme
Le sociologue et politologue polonais Yevhen Vyatr estime que presque toutes les organisations et mouvements sociopolitiques traversent plusieurs étapes dans leur développement :
1_Créer les conditions préalables au mouvement. Les problèmes réels et les contradictions deviennent la base de la discussion et l'émergence d'individus actifs qui offrent des options pour résoudre ces problèmes. Une vision commune du problème est développée.
2_Développement des fondements idéologiques et organisationnels. Le mouvement prend une position claire, crée un programme, organise des congrès d'organisation ou des discours des dirigeants du mouvement dans la presse ou la télévision.
3_Etape d'agitation. Pour toute organisation, le caractère de masse est la clé du succès.
4_ Stade d'activité politique élargie. Le travail du parti lui-même commence. Cette étape dépend de vos objectifs. Si les objectifs sont réalisables, l'étape peut ne pas durer longtemps ; si les objectifs sont inaccessibles ou difficiles à atteindre, l'étape peut s'étirer très longtemps.
5_Etape d'atténuation du mouvement. Un mouvement ou une organisation peut cesser d'exister lorsque l'objectif est atteint ou s'avère faux / inaccessible ; sous la pression des autorités ; quand il n'y a aucun moyen de continuer la lutte, etc.
Ces derniers temps (20-30 ans) dans de nombreux pays du monde, les mouvements dits alternatifs (AD) se sont le plus répandus. Ce sont de nouveaux mouvements sociaux cherchant à trouver des solutions originales à des problèmes mondiaux et à d'autres problèmes urgents : la prolifération des armes nucléaires, les ressources, l'écologie, la guerre et la paix, et la qualité de la vie. Les dirigeants de ces mouvements affirment que les anciennes structures politiques sont inefficaces et incapables de résoudre les problèmes mondiaux.
Ces mouvements sont impopulaires en Russie et populaires en Europe. Les personnes qui, en règle générale, n'ont pas de difficultés économiques participent à des mouvements alternatifs. Âge - de 18 à 35 ans, citadins, représentants de la classe moyenne, écoliers et étudiants. Le niveau d'instruction est élevé.
Les mouvements alternatifs les plus actifs et organisés sont :
1_Environnemental (Greenpeace, Monde faune et etc.).
2_Anti-guerre et anti-nucléaire.
3_Mouvement des droits civiques.
4_Organisations de partisans d'un mode de vie alternatif.
5_Féministe.
6_Mouvement des retraités.
7_Consommateur.
Les mouvements subsidiaires sont extrémistes, par exemple écologistes - Peta.
Systèmes de partis
Dans son fonctionnement dans le cadre système politique selon la nature et le nombre de partis, tous les partis d'un pays donné sont formés dans le soi-disant système de partis.
Il est d'usage de distinguer :
1) Systèmes à parti unique
2) Bipartite
3) Multipartisme
1e sont considérés comme un anachronisme et sont moins fréquents que d'autres (Chine, Corée du Nord, Cuba, Vietnam). Il y a une fusion des organes du parti et de l'État. Tout d'abord - le parti et le pouvoir exécutif.
Tout dépend des exigences imposées à un parti pour qu'il soit considéré comme un parti d'envergure sociale. L'une des exigences les plus strictes est celle de la Fédération de Russie.
La partie doit répondre aux exigences suivantes :
1) Composition - au moins 50 000 personnes
2) Doit avoir des succursales régionales dans plus de la moitié des entités constitutives de la Fédération de Russie
3) Plus ou la moitié des entités constitutives de la Fédération de Russie doivent avoir des antennes régionales d'au moins 500 personnes
2ème. Fonctionne dans les pays où il y a plusieurs partis (env. 20). Cependant, seuls 2 partis ont une réelle opportunité de remporter les élections législatives et d'accéder au pouvoir.
Les 2 partis les plus influents se succèdent au pouvoir (sous la forme classique il est représenté aux USA - Démocrates et Républicains). Dans certains pays, un système à 2 partis modifié (2 + 1, 2.5) fonctionne - un tel système s'est développé en Allemagne - XDC | XCC, SPD. Le Parti des démocrates libres - le rôle du pendule. A peu près le même système existe au Royaume-Uni.
Les analystes notent qu'un tel système présente des avantages évidents :
1) Commodité de choix pour les électeurs
2) Le système contribue à l'atténuation progressive des conflits idéologiques entre les partis et à leur transition vers des positions plus modérées
3) Permet de se rapprocher de l'idéal du « gouvernement responsable » : l'un est au pouvoir, l'autre est dans l'opposition.
Si les électeurs ne sont pas satisfaits du travail du gouvernement, ils votent pour le parti d'opposition lors des élections législatives.
3ème. Un système multipartite fonctionne, où il y a plusieurs partis assez importants et influents dans le pays, dont chacun remporte un nombre important de voix aux élections législatives. (Italie, Finlande, Grèce).
Dans un tel système, il peut y avoir jusqu'à 10 partis au parlement. Il y en aurait eu encore plus si le soi-disant « seuil/barrière électoral » n'avait pas été établi. En règle générale, il est de 5 %. En Fédération de Russie avant les élections de 2007. Était 5% - maintenant - 7%
Dans un système multipartite, les partis forment souvent des blocs électoraux lors des élections. En Fédération de Russie, de tels blocs pourraient être créés jusqu'en 2007. C'est interdit par la nouvelle loi.
de lat. libéralis - libre) - le nom de la "famille" des mouvements idéologiques et politiques, historiquement développée à partir de la critique rationaliste et éducative, qui aux 17-18 siècles. ont été soumis à la société de classe corporative d'Europe occidentale, à « l'absolutisme » politique et aux diktats de l'Église dans la vie laïque. Les fondements philosophiques des « membres de la famille libérale » ont toujours été incompatibles. Historiquement, les plus importantes d'entre elles sont : 1) la doctrine des « droits naturels » de l'homme et du « contrat social » comme fondement d'un système politique légitime (J. Locke et al., Contrat social) ; 2) le « paradigme kantien » de l'autonomie morale du « je » noumental et les concepts d'« état de droit » qui en découlent ; 3) les idées des "Scottish Enlightenment" (D. Hume, A. Smith, A. Ferguson, etc.) sur l'évolution spontanée des institutions sociales, poussée par l'inévitable rareté des ressources, conjuguée à l'égoïsme et à l'ingéniosité des personnes , liés cependant par des « sentiments moraux » ; l'utilitarisme (I. Betpam, D. Ricardo, J. S. Mill et autres) avec son programme du « plus grand bonheur pour le plus grand nombre », considérés comme des maximisateurs prudents de leur propre bénéfice ; 5) le "libéralisme historique", d'une manière ou d'une autre lié à la philosophie hégélienne, affirmant la liberté de l'homme, mais non comme quelque chose qui lui est inhérent "depuis sa naissance", mais comme, selon R. Collingwood, "acquis progressivement dans la mesure où une personne entre dans la possession consciente de sa propre personnalité par ... le progrès moral. Dans des versions modifiées et souvent éclectiques, ces différents fondements philosophiques sont reproduits dans les discussions modernes au sein de la « famille libérale ». Les grands axes de ces discussions, autour desquels se forment de nouveaux regroupements de théories libérales, reléguant au second plan la signification des différences de fondements philosophiques, sont les suivants. Premièrement, le libéralisme, en tant que objectif principal s'efforcer de "limiter le pouvoir coercitif de tout gouvernement" (F. Hayek) ou s'agit-il d'un problème secondaire, résolu en fonction de la manière dont le libéralisme fait face à sa tâche la plus importante - "maintenir les conditions sans lesquelles la libre réalisation pratique de ses capacités est impossible » (T. X. Green). L'essence de ces discussions est la relation entre l'État et la société, le rôle, les fonctions et la portée autorisée de l'activité du premier afin d'assurer la liberté de développement de l'individu et la libre coexistence des personnes. Deuxièmement, le libéralisme doit-il être « neutre en valeurs », une sorte de technique « pure » de protection de la liberté individuelle, quelles que soient les valeurs dans lesquelles elle s'exprime (J. Rawls, B. Ackerman), ou incarne-t-il certaines valeurs ? (humanité, tolérance et solidarité, justice, etc.), dont l'écart et le relativisme moral sans limites sont pour lui les conséquences les plus pernicieuses, y compris directement politiques (W. Galston, M. Walzer). L'essence de ce type est le contenu normatif du libéralisme et la dépendance à son égard du fonctionnement pratique des institutions libérales. Troisièmement, le différend entre le libéralisme « économique » et « éthique » (ou politique). La première est caractérisée par la formule de L. von Mises : « Si nous condensons tout le programme du libéralisme en un seul mot, alors ce sera la propriété privée... Toutes les autres exigences du libéralisme découlent de cette exigence fondamentale. Le libéralisme « éthique » soutient que le lien entre la liberté et la propriété privée est ambigu et non invariable dans différents contextes historiques. Selon B. Krone, la liberté "doit avoir le courage d'accepter les moyens du progrès social, qui... sont divers et contradictoires", ne considérant le principe du laissez-faire que comme "l'un des types possibles d'ordre économique".
Si diverses sortes libéralisme, classique et moderne, il est impossible de trouver un dénominateur philosophique commun et leurs approches des principaux problèmes pratiques diffèrent tellement, qu'est-ce qui permet alors de parler de leur appartenance à la même « famille » ? D'éminents chercheurs occidentaux rejettent la possibilité même de donner une définition unique au libéralisme : son histoire ne révèle qu'un tableau « de ruptures, d'accidents, de diversité... de penseurs indifféremment mêlés sous la bannière du « libéralisme » (D. Gray). La similitude des divers types de libéralisme à tous autres égards se révèle si on les considère non pas du côté de leur contenu philosophique ou politico-programmatique, mais comme une idéologie dont la fonction déterminante n'est pas de décrire la réalité, mais d'agir en conséquence. réalité, en mobilisant et en dirigeant l'énergie des gens vers certains objectifs. Dans des situations historiques différentes, la mise en œuvre réussie de cette fonction nécessite un appel à des idées philosophiques différentes et la promotion de cadres de programmes différents en relation avec un même marché, la « minimisation » ou l'expansion de l'État, etc. En d'autres termes, le seul La définition générale du libéralisme ne peut être qu'une fonction de la mise en œuvre de certaines valeurs-objectifs, qui se manifestent de manière spécifique dans chaque situation spécifique. La dignité et la mesure de la « perfection » du libéralisme ne sont pas déterminées par la profondeur philosophique de ses doctrines ou la fidélité à telle ou telle formulation « sacrée » sur la « naturalité » des droits de l'homme ou l'« inviolabilité » de la propriété privée, mais par sa capacité pratique (idéologique) à rapprocher la société de ses buts et non à lui donner de « s'introduire » dans un état qui leur est radicalement étranger. L'histoire a maintes fois démontré que les enseignements libéraux philosophiquement pauvres s'avéraient bien plus efficaces de ce point de vue que leurs « frères » philosophiquement raffinés et sophistiqués (comparons, par exemple, les « destins » politiques des opinions des « pères fondateurs " des États-Unis, tels qu'ils sont exposés dans les documents The Federalist, etc., d'une part, et le kantisme allemand, d'autre part). Quels sont les objectifs-valeurs stables du libéralisme, qui ont reçu diverses justifications philosophiques dans son histoire et se sont incarnés dans divers programmes d'action pratiques?
1. L'individualisme - dans le sens de la « primauté » de la dignité morale d'une personne sur tout empiètement sur elle par une équipe, quelles que soient les considérations d'opportunité qui appuient de tels empiétements. Compris donc. l'individualisme n'exclut pas a priori l'abnégation d'une personne si elle reconnaît les exigences du collectif comme « justes ». L'individualisme n'est pas lié d'une manière logiquement nécessaire aux idées d'une société « atomisée », dans le cadre desquelles et sur la base desquelles il s'est initialement affirmé dans l'histoire du libéralisme.
2. Égalitarisme - dans le sens de reconnaître à toutes les personnes une valeur morale égale et de nier l'importance pour l'organisation des institutions juridiques et politiques les plus importantes de la société de toute différence "empirique" entre elles (en termes d'origine, de propriété, de profession, sexe, etc). Un tel égalitarisme n'est pas nécessairement justifié selon la formule « tous naissent égaux ». Pour le libéralisme, il est important d'introduire le problème de l'égalité dans la logique de l'obligation ~ « tous doivent être reconnus moralement et politiquement égaux », qu'une telle introduction découle ou non de la doctrine des « droits naturels », la dialectique hégélienne du « esclave et maître » ou le calcul utilitaire de ses propres avantages stratégiques.
3. Universalisme - dans le sens de reconnaître que les exigences de dignité et d'égalité individuelles (au sens indiqué) ne peuvent être rejetées en se référant aux caractéristiques "immanentes" de certains groupes culturels et historiques de personnes. L'universalisme ne doit pas nécessairement être lié à des idées sur la "nature de l'homme" anhistorique et à la même compréhension de la "dignité" et de "l'égalité" par tous. Elle peut également être interprétée de telle sorte que dans chaque culture - conformément au caractère de développement humain qui lui est inhérent - il y ait un droit d'exiger le respect de la dignité et de l'égalité, telles qu'elles sont comprises dans leur certitude historique. Ce qui est universel, ce n'est pas exactement ce que les gens demandent dans différents contextes, mais comment ils demandent ce qu'ils demandent, à savoir, non pas en tant qu'esclaves recherchant des faveurs que leurs maîtres peuvent légitimement leur refuser, mais en tant que personnes dignes qui ont le droit de ce qu'ils demandent.
4. Le méliorisme comme affirmation de la possibilité de corriger et d'améliorer n'importe quelle institution sociale. Le méliorisme ne coïncide pas nécessairement avec l'idée de progrès en tant que processus dirigé et déterminé, à laquelle il a longtemps été historiquement associé. Le méliorisme permet également différentes idées sur la relation entre les principes conscients et spontanés dans la société en mutation - dans la gamme allant de l'évolution spontanée de Hayekado au constructivisme rationaliste de Bentham.
Avec cette constellation d'objectifs de valeur, le libéralisme s'affirme comme une idéologie moderne, distincte des enseignements politiques antérieurs. La limite ici peut être indiquée par la transformation du problème central. Tout pré-moderne pensée politique d'une manière ou d'une autre axée sur la question : « quel est le meilleur État et quels devraient être ses citoyens ? » Au centre du libéralisme se trouve une autre question : « comment l'État est-il possible si la liberté du peuple, capable de se déverser dans une volonté propre destructrice, est inamovible ? Tout libéralisme, au sens figuré, découle de deux formules de H. Hobbes : « Il n'y a pas de bien absolu, dénué de tout rapport à quoi que ce soit ni à personne » (c'est-à-dire que la question du « meilleur état en général » n'a pas de sens) et « nature du bien et du mal dépend de la totalité des conditions existant dans ce moment(c'est-à-dire que les politiques "correctes" et "bonnes" ne peuvent être définies qu'en fonction d'une situation donnée). Le changement de ces questions centrales a déterminé les grandes lignes de la pensée politique libérale, tracées par les lignes-positions suivantes : 1) pour qu'un État ait lieu, il doit inclure tous ceux qui sont concernés par cette question, et pas seulement les vertueux ou possédant certaines caractéristiques particulières qui les rendent aptes à la participation politique (comme ce fut le cas, par exemple, avec Aristote). C'est le principe libéral d'égalité, qui s'est rempli de contenu au cours de l'histoire du libéralisme, s'étendant progressivement à tous les nouveaux groupes de personnes exclues de la politique aux étapes précédentes. Il est clair que cette propagation s'est faite par la lutte démocratique contre les formes institutionnelles préexistantes du libéralisme avec leurs mécanismes inhérents de discrimination, et non par l'auto-déploiement des « principes immanents » du libéralisme. Mais autre chose est important : l'État et l'idéologie libérale étaient capables d'un tel développement, alors qu'auparavant formes politiques(la même politique ancienne) a échoué en essayant d'étendre leurs principes originaux et de les diffuser à des groupes d'opprimés ; 2) s'il n'y a pas de bien absolu, évident pour tous les participants à la politique, alors la réalisation de la paix présuppose l'hypothèse de la liberté de chacun de suivre ses propres idées sur le bien. Cette hypothèse est « techniquement » mise en œuvre en établissant des canaux (procéduraux et institutionnels) par lesquels les personnes satisfont leurs aspirations. Initialement, la liberté vient au monde moderne non pas sous la forme d'un "bon cadeau", mais sous la forme d'un terrible défi lancé aux fondements mêmes de la coexistence des gens par leur égoïsme violent. Le libéralisme devait reconnaître cette liberté grossière et dangereuse et la socialiser selon cette formule primitive de « liberté de » que le libéralisme primitif exprime avec tant d'emphase. Une telle reconnaissance, et ce qui en a découlé pour la théorie et la pratique politiques, est nécessaire à la réalisation de la possibilité même vivre ensemble les gens à l'époque moderne. (Au sens de la formule hégélienne - "la liberté est nécessaire", c'est-à-dire que la liberté est devenue une nécessité pour la modernité, ce qui, bien sûr, n'a que peu de choses à voir avec l'interprétation "dialectique-matérialiste" de cette formule par F. Engels - la liberté comme nécessité reconnue). Mais la nécessité de reconnaître la liberté sous sa forme brute ne signifie nullement que le libéralisme n'aille pas plus loin dans la compréhension et la pratique de la liberté. Si éthiquement le libéralisme aspirait à quelque chose, c'était à faire en sorte que la liberté devienne en soi une fin en soi pour les hommes. La formule de cette nouvelle compréhension de la liberté comme « liberté pour » peut être considérée comme la formule d'A. de Tocqueville : « Celui qui cherche dans la liberté autre chose que la liberté elle-même est créé pour l'esclavage » ; 3) si la liberté est reconnue (à la fois dans le premier et dans son second sens), alors la seule façon d'organiser l'État est le consentement de ses organisateurs et participants. Le sens et l'objectif stratégique de la politique libérale est de parvenir au consensus comme seul véritable fondement de l'État moderne. Mouvement dans cette direction - avec tous ses échecs, ses contradictions, l'utilisation d'outils de manipulation et de répression, ainsi que des moments de créativité historique et la réalisation de nouvelles opportunités pour l'émancipation des peuples - c'est la véritable histoire du libéralisme, son seule définition riche en contenu.
Lit.: Leonpyuwich VV L'histoire du libéralisme en Russie. 1762-1914. Moscou, 1995 ; Dunn J. Libéralisme.-Idem., La théorie politique occidentale face à l'avenir. Cambr.. 1993; Galston WA Libéralisme et morale publique.- Libéraux sur le libéralisme, éd. par A. Damico. Totowa (NJ), 1986 ; Gris). libéralisme. Milton Keynes, 1986 ; Hayek F. A. La Constitution et la Liberté. L., 1990; Holmes S. La structure permanente de la pensée antilibérale.- Le libéralisme et la vie morale, éd. par N. Rosenblum, Cambr. (Messe), 1991 ; Mills W. C. Valeurs libérales dans le Modem Vbrld.-Idem. Pouvoir, politique et peuple, éd. par I. Horowitz. NY, 1963 ; Rawls J. libéralisme politique. N.Y, 1993 ; Ruggiero G. de. L'histoire du libéralisme. L., 1927 ; Wallerstein 1. Après le libéralisme. N. Y., 1995, parties 2, 3.
Grande définition
Définition incomplète ↓
libéraux- des représentants du mouvement idéologique et socio-politique, réunissant les partisans du gouvernement représentatif et de la liberté individuelle, et dans l'économie - la liberté d'entreprendre.
informations générales
Le libéralisme est né en Europe occidentale à l'époque de la lutte contre l'absolutisme et la domination de l'Église catholique (XVIe-XVIIIe siècles). Les bases de l'idéologie ont été posées pendant la période des Lumières européennes (J. Locke, C. Montesquieu, Voltaire). Les économistes physiocratiques ont formulé le slogan populaire ne pas interférer avec l'action, exprimant l'idée de non-intervention de l'État dans l'économie. La justification de ce principe a été donnée par les économistes anglais A. Smith et D. Ricardo. Aux 18-19 siècles. l'environnement social des libéraux était principalement composé de couches bourgeoises. Les libéraux radicaux associés à la démocratie ont joué rôle important dans la Révolution américaine (incarnée dans la Constitution américaine de 1787). Aux XIXe et XXe siècles les principales dispositions du libéralisme ont été formées: société civile, droits et libertés individuels, état de droit, institutions politiques démocratiques, liberté d'entreprise privée et de commerce.

Principes du libéralisme
Les caractéristiques essentielles du libéralisme sont déterminées par l'étymologie du mot lui-même (lat. Libéral - libre).
Les grands principes du libéralisme se situent dans la sphère politique :
- la liberté de l'individu, la priorité de l'individu par rapport à l'État, la reconnaissance du droit de tous à l'épanouissement. Il convient de noter que dans l'idéologie du libéralisme, la liberté individuelle coïncide avec la liberté politique et les "droits naturels" de la personne, dont les plus importants sont le droit à la vie, à la liberté et à la propriété privée ;
- limitation de la sphère d'activité de l'État, protection de la vie privée - principalement contre l'arbitraire de l'État; « l'affaiblissement de l'État à l'aide d'une constitution qui garantit la liberté d'action de l'individu dans le cadre de la loi ;
- le principe du pluralisme politique, la liberté de pensée, d'expression, de croyance.
- délimitation de la sphère d'activité de l'Etat et de la société civile, non-ingérence du premier dans les affaires de la seconde ;
- dans la sphère économique - liberté de l'activité entrepreneuriale individuelle et collective, autorégulation de l'économie selon les lois de la concurrence et du marché libre, non-ingérence de l'État dans la sphère économique, inviolabilité de la propriété privée;
- dans le domaine spirituel - liberté de conscience, c'est-à-dire le droit des citoyens de professer (ou de ne pas professer) une religion quelconque, le droit de formuler leurs devoirs moraux, etc.

Succès et développement de la direction
Dans sa forme classique achevée, le libéralisme s'est imposé dans le système étatique de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la France et d'un certain nombre d'autres États européens dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais déjà à la fin du XIXe - début du XXe siècle. un déclin de l'influence de l'idéologie libérale est révélé, qui s'est transformé en une crise qui a duré jusqu'aux années 30 du XXe siècle, qui a été associée aux nouvelles réalités sociopolitiques de cette période.
D'une part, la libre concurrence laissée sans contrôle de l'État a conduit à l'autoliquidation de l'économie de marché du fait de la concentration de la production et de la formation de monopoles, ruiné les petites et moyennes entreprises ; d'autre part, la propriété illimitée a provoqué un puissant mouvement ouvrier, des bouleversements économiques et politiques, qui se sont surtout manifestés à la fin des années 20 x - début des années 30. 20ième siècle Tout cela nous a obligés à reconsidérer un certain nombre d'attitudes libérales et d'orientations de valeurs.
Ainsi, dans le cadre du libéralisme classique, se forme le néolibéralisme, dont de nombreux scientifiques associent l'origine aux activités du président américain F. D. Roosevelt (1933-1945). La remise en question concernait principalement le rôle économique et social de l'État. La nouvelle forme de libéralisme est basée sur les idées de l'économiste anglais D. Keynes.
néolibéralisme
À la suite de longues discussions et recherches théoriques dans la première moitié du 20e siècle. individuel principes de base libéralisme classique et a développé un concept actualisé de "libéralisme social" - le néolibéralisme.
Le programme néolibéral était basé sur des idées telles que :
- consensus des gouvernants et des gouvernés ;
- la nécessité de la participation des masses au processus politique ;
- démocratisation de la procédure de prise de décision politique (principe de "justice politique");
- régulation étatique limitée des sphères économique et sociale ;
- restriction par l'État des activités des monopoles;
- garanties de certains droits sociaux (limités) (droit au travail, à l'éducation, aux prestations de vieillesse, etc.).
De plus, le néolibéralisme présuppose la protection de l'individu contre les abus et les conséquences négatives du système de marché. Les valeurs fondamentales du néolibéralisme ont été empruntées par d'autres courants idéologiques. Il attire par le fait qu'il sert de base idéologique à l'égalité juridique des individus et à l'État de droit.

Formes
libéralisme classique
Le libéralisme est le courant idéologique le plus répandu qui s'est formé à la fin des XVIIe-XVIIIe siècles. comme l'idéologie de la classe bourgeoise. John Locke (1632-1704), philosophe anglais, est considéré comme le fondateur du libéralisme classique. Il a été le premier à séparer clairement des concepts tels que l'individu, la société, l'État, en distinguant les pouvoirs législatif et exécutif. La théorie politique de Locke, exposée dans les "Two Treatises on State Government", est dirigée contre l'absolutisme patriarcal et considère le processus socio-politique comme le développement de la communauté humaine de l'état de nature à la société civile et à l'autonomie gouvernementale.
L'objectif principal du gouvernement de son point de vue est de protéger le droit des citoyens à la vie, à la liberté et à la propriété, et afin de garantir de manière fiable les droits naturels, l'égalité et la liberté, les gens acceptent de créer un État. Locke a formulé l'idée de l'État de droit, affirmant qu'absolument tout organe de l'État doit obéir à la loi. À son avis, le pouvoir législatif de l'État devrait être séparé de l'exécutif (y compris le pouvoir judiciaire et les relations extérieures), et le gouvernement lui-même devrait également obéir strictement à la loi.
Libéralisme social et libéralisme conservateur
Fin XIX - début XX siècle. les représentants des tendances libérales ont commencé à ressentir la crise des idées du libéralisme classique, associée à l'aggravation des contradictions sociales et à la diffusion des idées socialistes. Dans ces conditions, de nouvelles tendances du libéralisme sont apparues - le "libéralisme social" et le "libéralisme conservateur". Dans le «libéralisme social», les idées principales étaient que l'État avait des fonctions sociales et que la responsabilité de subvenir aux besoins des couches les plus défavorisées de la société lui était assignée. Le "libéralisme conservateur", au contraire, a rejeté toute activité sociale de l'État. Sous l'influence du développement ultérieur des processus sociaux, l'évolution interne du libéralisme a eu lieu et, dans les années 30 du XXe siècle, le néolibéralisme est né. Les chercheurs attribuent le début du néolibéralisme au "New Deal" du président américain.
Libéralisme politique
Le libéralisme politique est la conviction que les individus sont la base du droit et de la société et que institutions publiques existent pour faciliter l'autonomisation des individus avec un pouvoir réel, sans s'attirer les faveurs des élites. Cette croyance en la philosophie politique et en la science politique s'appelle "l'individualisme méthodologique". Elle est basée sur l'idée que chacun sait le mieux ce qui est le mieux pour lui. La Magna Carta anglaise (1215) fournit un exemple de document politique dans lequel certains droits individuels s'étendent au-delà de la prérogative du monarque. Le point clé est le contrat social, par lequel les lois sont faites avec le consentement de la société pour son bien et la protection des normes sociales, et chaque citoyen est soumis à ces lois. Un accent particulier est mis sur l'Etat de droit, en particulier, le libéralisme procède du fait que l'Etat dispose d'un pouvoir suffisant pour le garantir. Le libéralisme politique moderne inclut également la condition du suffrage universel, sans distinction de sexe, de race ou de propriété ; la démocratie libérale est considérée comme le système préféré. Le libéralisme politique signifie un mouvement pour la démocratie libérale et contre l'absolutisme ou l'autoritarisme.

libéralisme économique
Le libéralisme économique prône les droits de propriété individuels et la liberté contractuelle. La devise de cette forme de libéralisme est "la libre entreprise privée". La préférence est donnée au capitalisme sur la base du principe de l'intervention non étatique dans l'économie (laissez-faire), ce qui signifie l'abolition des subventions de l'État et des barrières légales au commerce. Les libéraux économiques croient que le marché n'a pas besoin de réglementation gouvernementale. Certains d'entre eux sont prêts à autoriser le contrôle gouvernemental des monopoles et des cartels, d'autres soutiennent que la monopolisation du marché ne se produit qu'à la suite d'actions gouvernementales. Le libéralisme économique soutient que la valeur des biens et services doit être déterminée par le libre choix des individus, c'est-à-dire par les forces du marché. Certains autorisent la présence des forces du marché même dans des domaines où l'État détient traditionnellement un monopole, comme la sécurité ou la justice. Le libéralisme économique considère l'inégalité économique qui découle de positions inégales dans les contrats comme un résultat naturel de la concurrence, à condition qu'il n'y ait pas de coercition. Actuellement forme donnée les plus prononcés dans le libertarianisme, les autres variétés sont le minarchisme et l'anarcho-capitalisme. Ainsi, le libéralisme économique est pour la propriété privée et contre la réglementation étatique.
libéralisme culturel
Le libéralisme culturel se concentre sur les droits individuels liés à la conscience et au mode de vie, y compris des questions telles que la liberté sexuelle, religieuse, académique, la protection contre l'ingérence de l'État dans la vie privée. Comme l'a dit John Stuart Mill dans son essai « On Liberty » : « Le seul but qui justifie l'intervention de certaines personnes, individuellement ou collectivement, dans les activités d'autres personnes, est la légitime défense. Exercer un pouvoir sur un membre d'une société civilisée contre sa volonté n'est permis que dans le but d'empêcher de nuire à autrui. Le libéralisme culturel, à des degrés divers, s'oppose à la réglementation par l'État de domaines tels que la littérature et les arts, ainsi que de questions telles que les activités du milieu universitaire, jeux d'argent, la prostitution, l'âge du consentement aux rapports sexuels, l'avortement, l'utilisation de contraceptifs, l'euthanasie, la consommation d'alcool et d'autres drogues. Les Pays-Bas sont probablement aujourd'hui le pays au plus haut niveau de libéralisme culturel, ce qui n'empêche cependant pas le pays de proclamer une politique de multiculturalisme.
Libéralisme de troisième génération
Le libéralisme de la troisième génération était le résultat de la lutte d'après-guerre des pays du tiers monde contre le colonialisme. Elle est aujourd'hui plus associée à certaines aspirations qu'à des normes juridiques. Son but est de lutter contre la concentration du pouvoir, des ressources matérielles et de la technologie dans un groupe de pays développés. Les militants de ce courant mettent l'accent sur le droit collectif de la société à la paix, à l'autodétermination, à la développement économique et l'accès aux biens communs humains (ressources naturelles, savoir scientifique, monuments culturels). Ces droits appartiennent à la "troisième génération" et sont reflétés dans l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les défenseurs des droits humains internationaux collectifs portent également une attention particulière aux questions d'écologie internationale et d'aide humanitaire.
Résultat
Toutes les formes de libéralisme ci-dessus supposent qu'il devrait y avoir un équilibre entre les responsabilités du gouvernement et des individus, et que la fonction de l'État devrait être limitée aux tâches qui ne peuvent pas être correctement exécutées par le secteur privé. Toutes les formes de libéralisme visent la protection législative de la dignité humaine et de l'autonomie personnelle, et toutes soutiennent que l'abolition des restrictions à activité individuelle contribue à l'amélioration de la société. Le libéralisme moderne dans la plupart des pays développés est un mélange de toutes ces formes. Dans les pays du tiers monde, le "libéralisme de troisième génération" vient souvent au premier plan - un mouvement pour un environnement sain et contre le colonialisme. Le libéralisme en tant que doctrine politique et juridique repose sur l'idée de la valeur absolue et de l'autosuffisance de l'individu. Selon le concept libéral, ce n'est pas la société qui précède et socialise les individus, mais les individus indépendants créent la société elle-même conformément à leur propre volonté et esprit - toutes les institutions sociales, y compris politiques et juridiques.

Le libéralisme dans la Russie moderne
Le libéralisme est plus ou moins courant dans tous les pays développés modernes. Cependant, dans la Russie moderne le terme a acquis une connotation négative importante, puisque le libéralisme est souvent compris comme les réformes économiques et politiques destructrices menées sous le règne de Gorbatchev et d'Eltsine, un niveau élevé de chaos et de corruption, masqué par une orientation vers pays de l'Ouest. Dans cette interprétation, le libéralisme est largement critiqué en raison de la crainte d'une nouvelle destruction du pays et de la perte de son indépendance. La libéralisation moderne conduit souvent à une réduction de la protection sociale, et la « libéralisation des prix » est un euphémisme pour « augmenter les prix ».
Les fans de l'Occident ("classe créative") sont généralement considérés comme des libéraux radicaux en Russie, incluant dans leurs rangs des personnalités très spécifiques (Valeria Novodvorskaya, Pavel Shekhtman, etc.) qui détestent la Russie et l'URSS en tant que telles, en les comparant par exemple à L'Allemagne nazie, et Staline et Poutine - avec Hitler, déifiant les États-Unis. Des ressources bien connues de ce genre : Echo de Moscou, The New Times, Ej, etc. L'opposition, qui a organisé des manifestations de masse contre le gouvernement russe en 2011-2012, s'est désignée comme libérale. en raison d'un désaccord avec la nomination et l'élection de Poutine pour un troisième mandat. Mais il est intéressant de noter qu'au même moment, le président russe Vladimir Poutine, par exemple, s'est qualifié de libéral, des réformes libérales ont été proclamées par Dmitri Medvedev lorsqu'il était président de la Russie.